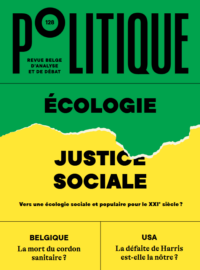Écologie • Environnement
Un militantisme en quête de stratégie. Penser la suite de Code Rouge
22.04.2025

Les 26 et 27 octobre 2024, le mouvement écologiste Code Rouge a mobilisé un millier de militant·es pour bloquer les accès menant à deux des sites stratégiques de TotalEnergies en Belgique, à Anvers et à Feluy (voir notamment Politique, n° 124). Cette quatrième action d’envergure menée par le collectif depuis sa fondation, fin 2022, marque son affirmation comme un acteur de poids au sein de la société civile belge. Toutefois, cette montée en puissance entraîne aussi des questionnements que les activistes ne pourront pas éviter.
7 octobre 2022. Ça y est : la Belgique va connaitre l’une de ses premières actions de désobéissance civile de masse. À l’issue de nombreuses réunions et de longs préparatifs, et à l’appel du mouvement Code Rouge, plus de 1000 personnes se lancent à l’assaut du géant pétrolier et gazier TotalEnergies et, en particulier, de deux de ses sites : celui de Feluy et celui de Wandre (Liège). Durant les deux années suivantes, les activistes remettront trois fois le couvert, en visant cette fois Engie (juillet 2023), les aéroports de Deurne (Anvers) et de Liège (décembre 2023), puis, de nouveau, TotalEnergies (octobre 2024).
Les origines d’un mouvement de désobéissance civile de masse
L’émergence de Code Rouge, mouvement soutenu par plusieurs organisations et groupes d’action issus de la société civile belge (comme Greenpeace, Stop Alibaba & Co, Extinction Rebellion Belgium, le Réseau ADES, la Gauche anticapitaliste, Youth For Climate, Ineos Will Fall, Grands-Parents pour le Climat, Grootouders voor het Klimaat, Vredesactie, Agir pour la Paix, Climaxi, Climate Express, Tegengas, Better.planet.online, …), à la fin de cette année 2022, résulte en quelque sorte d’un double processus de radicalisation du Mouvement climat.
Une radicalisation des modes d’action tout d’abord. Comme le souligne Code Rouge sur son propre site, ses mobilisations répondent en effet à l’inaction politique qui a suivi les marches pour le climat de 2018-2019 : face au constat que les citoyen·nes, « descendu·es dans la rue par millions pour exiger des politiques climatiques et sociales ambitieuses et équitables »1, n’ont pas été suffisamment entendu·es, les personnes à l’initiative de Code Rouge ont jugé nécessaire de passer à ce qu’elles désignent comme « la vitesse supérieure », à savoir la désobéissance civile de masse. Ce faisant, elles s’inspirent explicitement d’autres « plateformes d’action similaires à l’étranger, telle qu’Ende Gelände »2.
Outre cette radicalisation des modes d’action, Code Rouge participe également à une forme de radicalisation des revendications du Mouvement climat (un phénomène qui n’est d’ailleurs pas propre à la Belgique). En 2018-2019, les mots d’ordre mis en avant durant les marches pour le climat étaient en effet assez souvent dépolitisants, naïfs, individualisants, scientistes… : beaucoup d’activistes appelaient à « écouter les scientifiques », à « déclarer l’état d’urgence écologique », à « agir » (tout simplement)…
Aujourd’hui, même s’il reste des traces de ces mots d’ordre, force est de constater que le Mouvement s’est fortement politisé et radicalisé. Ainsi, j’étais présent lors de la dernière action de Code Rouge, et j’ai été assez marqué par le fait que les chants, les banderoles et les discussions entre activistes appelaient explicitement à défendre une écologie décroissante, anticapitaliste, émancipatrice, décoloniale, féministe…
Ce changement s’explique sans doute par les rencontres que les militant·es des marches pour le climat ont pu effectuer au fil de leur engagement, initié en 2018 (ou bien avant, ou après cette période). En s’investissant dans d’autres luttes (antiracistes, féministes, etc.) ou dans des plateformes comme Code Rouge (qui facilitent le rapprochement entre activistes et collectifs issu·es de milieux militants variés), ces activistes ont en effet été exposé·es à d’autres organisations, qui ont pu faire évoluer leur vision de l’écologie, rendant celle-ci davantage intersectionnelle3. Une telle politisation apparaît essentielle pour permettre aux militant·es de saisir pleinement les causes structurelles du ravage écologique en cours, que sont notamment le productivisme, le capitalisme, le colonialisme et le patriarcat.
Les défis théoriques et stratégiques de Code Rouge
L’apport de Code Rouge à ce processus de politisation ne doit toutefois pas occulter les défis importants auxquels le mouvement est actuellement confronté. Bien que des discussions aient eu lieu à ce propos en interne, ces derniers mois, il semble par exemple qu’il manque encore une réflexion théorique, idéologique et stratégique plus approfondie au sein du collectif. Le site de Code Rouge, ses publications sur les réseaux sociaux et ses communiqués de presse laissent en effet percevoir une certaine ambiguïté quant aux finalités précises de ses actions. Pour reprendre l’exemple le plus récent : en octobre, les activistes ont bloqué des infrastructures de TotalEnergies pendant deux jours, certes, mais dans quel objectif à moyen/long terme ? Un flou persiste dans la réponse apportée à cette question, et ce flou pourrait donner l’impression que Code Rouge tombe dans « l’action pour l’action », que ses mobilisations s’enchaînent sans cohérence globale. À ce titre, de l’inspiration pourrait être trouvée à l’étranger : actuellement, les Soulèvements de la Terre (France) se positionnent probablement comme le mouvement écologiste le plus influent en Europe, et ils ont publié un livre, en avril 2024. Intitulé Premières secousses4, ce livre, qui propose une riche réflexion stratégique et idéologique, pourrait aider Code Rouge à se donner une épaisseur conceptuelle et théorique plus importante.
De manière assez proche, une réflexion pourrait également être entamée au niveau médiatique. À l’issue de chaque action, de nombreux et nombreuses activistes éprouvent en effet une profonde frustration, face au fait qu’on ne parle déjà plus de Code Rouge dans la presse et dans le débat public, à peine un ou deux jours après la fin des mobilisations. Si les médias portent clairement une part de responsabilité dans cette situation, cela donne également l’impression que le mouvement peine à inscrire ses actions dans le cadre de « momentums politiques » bien précis, et à réaliser un vrai suivi médiatique des actions une fois les blocages levés, afin de créer du débat autour des cibles concernées. À l’inverse, encore une fois, il semble que des plateformes comme les Soulèvements de la Terre parviennent davantage à ne pas tomber dans ce piège : en s’inscrivant dans le « momentum politique » né autour des méga-bassines, ou de l’A69, et en communiquant très largement avant, pendant et après leurs actions, ils ont réussi à créer du débat en France sur la question de l’accaparement de l’eau et des terres, et ce pendant plusieurs mois !
Enfin, à l’instar d’autres groupements politiques collectifs (comme les partis ou les syndicats), les mouvements sociaux écologistes se heurtent au défi de la transition juste et (im)populaire. Cela s’explique aisément : écologie et social sont intrinsèquement connectés, puisque toute forme de politique écologique aura des implications sociales. Cette caractéristique n’est d’ailleurs pas propre à l’écologie : elle s’applique également à d’autres domaines de politique publique, tels que la santé, la mobilité ou l’éducation. Ici aussi, les politiques mises en œuvre pour répondre aux enjeux soulevés n’affectent jamais uniformément l’ensemble de la population : les inégalités (économiques, géographiques…) présentes initialement entre groupes sociaux sont soit atténuées, soit exacerbées par ces mesures.
Dans le cas précis de l’écologie, la réduction de l’empreinte écologique des sociétés humaines « ne peut que passer par la rétraction, voire la fermeture de secteurs économiques entiers (aviation, énergies fossiles, luxe…), tandis que d’autres pourront ou devront être maintenus »5. Se pose alors la question du devenir des travailleurs et travailleuses de ces secteurs qui devront être fermés ou rétractés. Pour que cette transition/décroissance ne s’effectue pas à leurs dépens, la réorientation des objectifs de la production ne peut être effectuée par la classe capitaliste, la seule classe qui en est actuellement capable (parce qu’elle détient les moyens de production), au risque que celle-ci assure, ce faisant, « le maintien de sa position sociale dominante »6. Plutôt, cette réorientation doit être enclenchée par les travailleurs et travailleuses, qui doivent pouvoir décider de la manière la plus démocratique qui soit, ce dont chacun·e a besoin pour vivre, et cela nécessite une socialisation de la production. Cet enjeu est de mieux en mieux compris au sein de Code Rouge : depuis l’action visant Engie, la socialisation du secteur de l’énergie fait d’ailleurs partie des revendications du mouvement7.
En outre, si la première action de Code Rouge, visant TotalEnergies, avait suscité un certain nombre de tensions avec les travailleurs et travailleuses de l’entreprise et leurs délégué·es, un travail de fond est désormais engagé à ce sujet au sein d’un groupe de travail dédié, le GT Syndicats. Celui-ci a notamment permis de tisser des liens étroits avec certaines centrales de la FGTB et de la CSC. Ces rapprochements visent à convaincre les syndicats ainsi que les travailleurs et travailleuses de deux choses. Premièrement, que Code Rouge souhaite une transition qui se fasse à leur bénéfice, et non à leur détriment. Deuxièmement, que les syndicats et les mouvements sociaux écologistes peuvent donc s’unir autour d’une ligne commune « rouge-verte » et, ainsi, constituer un rapport de force plus important face à la classe dominante. Dans ce cadre, le défi pour Code Rouge restera de réussir à se lier à d’autres centrales syndicales, que celles qui lui sont, « traditionnellement », déjà favorables8.
Pour une clarification du projet politique de Code Rouge
Si Code Rouge matérialise donc une forme de radicalisation du Mouvement climat, à travers ses modes d’action et ses revendications, le chemin reste encore long à parcourir pour les activistes, si ces dernier·es souhaitent maintenir leur engagement dans un contexte militant et politique de plus en plus hostile, caractérisé par une criminalisation croissante des mouvements sociaux.
Les actions de Code Rouge sont en effet ambitieuses, mais il serait dommage de les voir se succéder indéfiniment sans tenir compte de trois angles importants. Premièrement, il convient de mener une véritable réflexion sur ce à quoi le mouvement veut aboutir à moyen ou long terme ; deuxièmement, il faut pouvoir se questionner sur sa stratégie médiatique, afin que celle-ci puisse générer de vrais débats au sein de la société, sur un temps assez long ; troisièmement, le rapport de force engagé par Code Rouge avec les forces du capitalisme productiviste doit être élargi à d’autres composantes majeures du mouvement social, comme les syndicats, puisque des convergences d’intérêt claires existent avec celles-ci.
Bref : la radicalisation proposée par Code Rouge est nécessaire, mais insuffisante en soi. Elle n’a en effet que peu de sens, si elle ne se couple pas à la clarification du projet politique porté par le mouvement. Une tâche qui sera loin d’être simple, au vu de la diversité des organisations composant Code Rouge ; mais une tâche qui devra impérativement être menée à bien si le collectif ne souhaite pas conduire ses activistes à une forme de désillusion militante dans les années à venir.
Cette analyse est parue en version abrégée dans la revue Politique n°128.