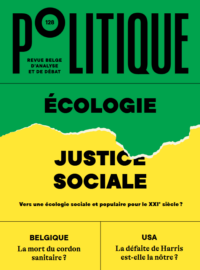Écologie • Politique
Pour une écologie vraiment populaire (1/3). Paul Magnette (PS)
27.12.2024

Qui mieux que les trois responsables de partis de gauche francophone (PS, Écolo et PTB), pour prendre le pouls politique de la thématique écologique, en cet hiver belge 2024-2025 ? Le président du parti socialiste (PS), Paul Magnette, défend de longue date un écosocialisme de « la vie large » auquel il a consacré plusieurs ouvrages ; Marie Lecocq, nouvelle coprésidente d’Écolo avec Samuel Cogolati, s’est fait élire par les militantes et militants avec la promesse d’une « écologie populaire » ; Raoul Hedebouw, président du parti du travail de Belgique (PTB), a hissé quant à lui le sujet de l’écologie en haut des priorités officielles et défend une «politique climatique sociale ».
De nombreux écologistes, de tous partis ou sans parti, souffrent du sentiment d’être incompris : les dérèglements climatiques sont le grand défi de l’époque, étayés par un savoir scientifique incontestable, et pourtant nous peinons à imposer ces thèmes à l’agenda. Issus la plupart du temps de milieux socio-culturels privilégiés, ils ont en outre l’impression que les milieux populaires, à qui ils ne veulent pourtant que du bien, forment le premier front des résistances.
Les résistances sont bien réelles, dont le récent backlash écologique, un peu partout en Europe, est le signe éclatant.
Ayant gouverné une grande ville pendant douze ans, et tenté d’y imprimer mes convictions écosocialistes, je ne partage pas cette analyse. Dans les réunions de quartier, les enquêtes et les porte-à-porte, j’ai constaté au contraire que les milieux populaires ne sont pas hostiles au changement – au contraire, c’est l’absence de changement qui les inquiète – et que les attentes qu’ils expriment s’inscrivent spontanément dans la perspective d’une société décarbonée. Les mamans vivant seules avec leurs enfants dans les logements sociaux, par exemple, réclament davantage de nature et d’espaces de jeux, des rues plus calmes, moins polluées et mieux sécurisées, des logements mieux isolés, des transports en commun efficaces et accessibles, une alimentation saine… Exactement ce qui est nécessaire, selon le meilleur état de la science, pour assurer la transition de nos modes de production et de consommation.
Les résistances, pourtant, sont un fait bien réel, dont le récent backlash écologique, un peu partout en Europe, est le signe éclatant. Elles tiennent pour partie à des phénomènes politiques généraux, qui sont révélés et amplifiés par les enjeux de la transition, mais qui n’y sont pas intrinsèquement liés. Le discours écologique apparaît d’abord comme une vérité révélée, assénée par des scientifiques et des technocrates accusés d’ignorer les réalités de la vie quotidienne.
Les milieux populaires ne sont pas hostiles au changement.
Au même titre que les combats féministe ou antiraciste, il est en outre souvent perçu comme une nouvelle forme de « supériorité morale » – le vieux péché de la gauche. Enfin, altérant profondément nos modes de vie, il heurte de plein fouet nos cultures et références, y compris sur des sujets à forte portée identitaire, comme la consommation de viande, la chasse, la corrida ou l’abattage rituel. La droite et l’extrême droite l’ont bien compris, qui marient dans une même rhétorique du refus tout ce qui menace nos cadres de vie – les étrangers, les bobos et les wokistes, l’Union européenne… Rien de nouveau sous le soleil – « Il faut arrêter d’emmerder les Français », disait déjà Pompidou il y a un demi-siècle.
Si la gauche veut contrer cette opposition, elle doit commencer par mesurer la manière dont la transition est vécue dans les groupes sociaux et les territoires. Les réactions les plus hostiles auxquelles j’ai dû faire face venaient rarement des milieux populaires, mais plutôt des classes moyennes supérieures, habitant les périphéries résidentielles des villes, très attachées à leur mode de vie, et qui ne comprenaient pas que l’on transforme les quartiers centraux plutôt dans l’intérêt de ceux qui y vivent au quotidien que dans celui de ceux qui la fréquentent de manière occasionnelle. Cette opposition doit être prise au sérieux.
Au même titre que les combats féministe ou antiraciste, le discours écologiste est souvent perçu comme une nouvelle forme de « supériorité morale ».
D’abord, parce que c’est effectivement le mode de vie des classes moyennes supérieures qui est le plus directement menacé par la perspective de la transition – ce qui explique le succès, dans ces milieux, des théories qui prétendent que les avancées technologiques permettront d’atteindre la neutralité carbone sans qu’il soit nécessaire de changer d’habitudes.
Si l’on ne croit pas à la capacité de la technique de tout résoudre, si l’on mesure la limite d’une argumentation scientifique abstraite, et si l’on ne se résigne pas à voir la question écologique devenir un nouveau lieu de la lutte des classes, il faut inventer un nouveau compromis social-démocrate, ancré dans une large coalition. Cela passe d’abord par la réédition des politiques publiques qui ont fait leurs preuves dans les décennies d’après-guerre : un vaste programme d’investissements, planifié à moyen et long terme, visant à améliorer les conditions de vie des milieux populaires et de la classe moyenne, et assurant un relais de croissance qui doit permettre de renouer avec le plein emploi – une altercroissance, bien sûr, c’est-à-dire une augmentation de la prospérité collective qui respecte les limites naturelles. Il faut ensuite accorder à la méthode une attention particulière.
Il faut inventer un nouveau compromis social-démocrate, ancré dans une large coalition.
Ensuite parce que ce mode de vie « ruisselle », pour utiliser un mot à la mode, vers d’autres groupes sociaux : depuis les débuts du capitalisme, on observe que les standards de consommation sont généralement définis par ce que l’on appelait naguère la bourgeoisie, et qu’ils ont tendance à s’étendre au fil du temps aux autres catégories sociales. La résistance des classes moyennes supérieures est susceptible de déteindre sur les autres groupes sociaux, qui craignent d’être privés des plaisirs auxquels ils rêvent d’accéder.
Les réactions hostiles que suscitent par exemple les politiques favorisant la mobilité douce ne s’expliquent pas seulement par un attachement à la voiture, qui serait irrationnel. Mais aussi par leur caractère parfois autoritaire, et surtout par le fait qu’elles ne prennent pas assez en compte leurs effets induits sur les différents groupes sociaux : une famille à hauts revenus pourra aisément changer de voiture pour continuer à entrer dans une « zone à basse émission », qui restera interdite à ceux qui n’ont pas cette chance ; la piétonnisation d’un quartier, accompagnée du renforcement de la mobilité douce et collective, en revanche, met tout le monde sur le même pied d’égalité.
Seule une transition améliorant les conditions de vie des milieux populaires et de la classe moyenne est susceptible de s’inscrire dans la durée.
Rendre l’écologie populaire est un défi de taille – nous sommes entrés, après tout, dans l’une des plus profondes transformations énergétiques que l’humanité ait connues – et personne ne peut prétendre en détenir la clef. Mais des expériences récentes, on peut tirer au moins deux leçons utiles. Se souvenir, d’abord, que les politiques publiques affectent toujours les groupes sociaux et des territoires de manière inégale, et que seule une transition améliorant substantiellement les conditions de vie des milieux populaires et de la classe moyenne est susceptible de s’inscrire dans la durée. Ne pas oublier, ensuite, qu’en politique, les moyens sont la condition de la fin, et que les compromis ne se forment que dans le conflit, et l’art subtil d’en sortir.