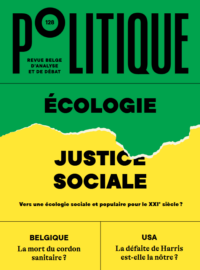Féminisme
Maïté Meeus, fondatrice de « balance ton bar »
31.01.2025

Si Maïté Meeus est devenue une figure féministe en Belgique en tant que fondatrice de « balance ton bar », son combat et son nom n’ont pas encore acquis la notoriété qui serait peut-être la leur, s’ils étaient associés à une autre cause.
C’est en octobre 2021, se souvient Maïté Meeus, que j’ai vu des témoignages émerger sur les réseaux sociaux. Selon eux, des clientes étaient droguées par un barman et ensuite violées, avec presque aucun souvenir des faits. Les gens évoquaient des actions prétendument « isolées ». J’ai donc lancé un appel à témoignages en garantissant l’anonymat, pour montrer leur dimension systémique. Le mouvement a pris une ampleur inattendue, avec des centaines de messages. » C’était le début de « Balance ton bar », une plateforme qui réunit à présent 33000 personnes sur Instagram.
Une approche parfois mal comprise
Si cette démarche semble aujourd’hui une évidence pour bon nombre, elle continue à interroger : « de nombreuses personnes critiquent la libération de la parole sur les réseaux sociaux, en évoquant les risques de fausses accusations, relève Maïté. Pourtant, ce phénomène s’explique largement par une faillite du système judiciaire dans la protection des victimes. Le taux de condamnation des auteurs de violences sexuelles est extrêmement bas. Les victimes, quant à elles, doivent affronter un véritable parcours de la combattante : passer par la police, un procès, engager des frais, se retrouver dans une situation psychologique fragile, pour finalement voir leur dossier classé sans suite. Face à cela, elles se tournent vers des alternatives, un « système B ». »
La libération de la parole sur les réseaux sociaux s’explique largement par une faillite du système judiciaire dans la protection des victimes.
Ainsi, « sur les réseaux, certains noms reviennent régulièrement, et une véritable sororité se crée. Je repense aux manifestations de “Balance ton bar” : ces moments étaient magnifiques. Des femmes se prenaient dans les bras, se disaient “« je te crois ”». Il y avait une énergie incroyable, un véritable souffle d’espoir collectif. Avec Gisèle Pélicot et l’affaire dite des « viols de Mazan », la soumission chimique est de nouveau au cœur du débat public : « c’est indétectable, pointe la militante. Il y a quelques années, c’était un peu un mythe urbain : “ah oui, peut-être que tu t’es faite droguer, mais comment le prouver ?” Avec les affaires françaises, on voit que c’est réel et on commence à croire les victimes. On a lancé un appel à manifestation et en moins de 24 heures, nous avons réuni plus de 300 personnes, ça montre à quel point le sujet mobilise ! »
Le cas de Gisèle Pelicot est édifiant : même avec une situation aussi évidente, elle a été humiliée.
Et que dire de la dimension internationale ? « Ce procès est un vrai évènement pour le mouvement féministe mondial. Ce qui a particulièrement choqué, ce sont les aberrations de la défense : des avocats qui prétendent que le viol dépend d’une « question d’intentionnalité » et pas de consentement, ou une avocate se moquant ouvertement sur Instagram. Cela a également mis en lumière le traitement des victimes par l’appareil judiciaire. Le cas de Gisèle est édifiant : même avec une situation aussi évidente – droguée par son propre mari, sans aucun consentement possible – elle a été humiliée. Si une affaire aussi claire suscite un tel traitement, que dire d’une jeune femme de 19 ans qui rentrerait d’une boîte avec quelqu’un et serait ensuite agressée ? On comprend alors pourquoi tant de victimes renoncent à porter plainte. »
Un difficile accompagnement
Le rôle de Maïté dans le cadre de Balance ton bar est loin d’être aisé : « au-delà du partage des témoignages sur la plateforme, mon rôle est de recevoir cette parole et de présenter les différentes étapes du processus. Si la personne estime que c’est trop difficile, je respecte totalement sa décision.
Une demande récurrente, cependant, est l’accès à un soutien psychologique. Au début, se remémore Maïté, je redirigeais vers une liste de psychologues que je connaissais. Mais de nombreuses personnes qui témoignent sont précaires, et les centres spécialisés sont souvent saturés. C’est pour cela que j’ai créé Artémise. C’est un réseau de psychologues dédiés aux victimes, avec des soins gratuits, car personne ne devrait avoir à payer pour se reconstruire. Ce travail est extrêmement chronophage, tout comme la gestion de Balance ton bar. »
Militantisme en ligne : un mal nécessaire ?
« Ce travail militant, essentiel mais non rémunéré, est épuisant et repose aussi sur du travail de l’ombre, souligne-t-elle. Le quotidien des activistes comme moi est loin des idées reçues : personne n’en vit vraiment. Récemment, j’ai reçu un prix du magazine Forbes pour mon action. C’est le paradoxe de la méritocratie individuelle poussée à l’extrême. Accepter ce type de reconnaissance soulève des questions éthiques. Faut-il refuser pour préserver une pureté militante ou accepter pour renforcer la visibilité des luttes, malgré certains compromis ? C’est une tension permanente. Ce qui est important pour moi c’est de rappeler l’importance du collectif. Que ce soit les femmes politiques qui ont créé les Centres de prise en charge des violences sexuelles (CPVS), les colleuses, thérapeutes ou créatrices de contenus, on a toutes un rôle à jouer.
Politique invite ses lectrices et lecteurs à consulter les témoignages de @Balancetonbar sur Instagram et soutenir les femmes témoignant de faits similaires.