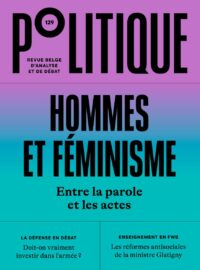Féminisme • Politique
Le consentement, la parole et les actes. Portrait d’une nouvelle génération d’hommes qui adhèrent au féminisme
08.04.2025

Non, tous les jeunes hommes ne sont pas réactionnaires et masculinistes. Dans la nouvelle génération se trouvent aussi des hommes se définissant comme pro féministe, qui souhaitent vivre en cohérence avec leurs idées d’égalité des genres. Mais prendre conscience de ses propres comportements problématiques ne va pas de soi.
Une enquête sur l’émergence du discours féministe chez les jeunes hommes universitaires en Belgique1 révèle que, face aux antiféministes et masculinistes, certains jeunes hommes valorisent une nouvelle forme de masculinité fondée sur un discours proféministe. Il est cependant essentiel de s’interroger sur la cohérence entre ce discours et les comportements concrets de ces jeunes hommes au quotidien.
Bien que le féminisme semble influencer positivement les hommes cis2 hétérosexuels sur leurs relations et leurs perceptions des violences de genre, la déconstruction des comportements problématiques masculins dans une société patriarcale reste un défi.
La difficulté d’assumer les agressions commises
Dans le cadre privé, notamment au sein du couple, comment les jeunes hommes incarnent-ils ces discours dans leur vie sexuelle et affective ? Bien que l’on observe chez certains un passage de la parole aux actes, cette adhésion au féminisme ne va pas sans contradictions.
Les agresseurs sont techniquement partout, pourtant on ne les trouve nulle part.
Lors d’un entretien avec Louis3, étudiant, ce dernier m’avoue qu’il « (n’a lui-même) pas trop respecté, le truc de la tasse de thé, une fois ». Ce « truc de la tasse de thé », fait référence à la notion de consentement4 : Louis reconnaît avoir, au moins une fois, dépassé cette limite et abusé d’une femme. Mais rares sont les hommes prêts à l’assumer. La libération de la parole autour des agressions sexuelles a progressé du côté des victimes, cependant, les agresseurs restent dans le silence. Pourtant, en prenant en compte mon expérience personnelle, ainsi que celles des femmes de mon entourage, les agresseurs sont dans l’écrasante majorité des hommes qui nous sont proches. Autrement dit, les agresseurs sont techniquement partout, pourtant on ne les trouve nulle part.
Une société qui déresponsabilise
La difficulté à prendre conscience que l’on a abusé de sa compagne relève de facteurs multiples. J’en relèverai deux. Si structurellement, dans notre ère « post-#MeToo », le discours social a criminalisé le viol, il n’empêche que l’imaginaire collectif persiste à penser l’agresseur comme étant la figure repoussoir de l’homme issu de classe populaire, racisé et souffrant de pathologies, dont il est aisé de se distancer lorsque l’on appartient aux classes moyennes ou supérieures blanches.
L’imaginaire collectif persiste à penser l’agresseur comme étant la figure repoussoir de l’homme issu de classe populaire, racisé et souffrant de pathologies.
Ensuite, cette minimisation de la responsabilité individuelle est renforcée par une tendance sociale et judiciaire à infantiliser les hommes auteurs d’agressions sexuelles. Par exemple, lors du procès de Mazan en septembre 2024, la défense qualifie les accusés de « garçons », suggérant ainsi une incapacité à être pleinement responsables de leurs actes. Cette rhétorique contribue à diminuer la gravité de leurs actions et à réduire la responsabilité des auteurs.
L’influence des idées féministes dans le couple
Malgré ces obstacles, certains hommes proféministes affirment que les idées féministes ont eu un impact positif sur leurs comportements au sein du couple. Influencés par les femmes de leur entourage, ils commencent à prendre conscience de l’ampleur des violences de genre. Cette sensibilisation pousse certains à réexaminer leurs comportements et à y apporter des changements, que ce soit en soutenant directement des femmes (les ramener chez elles après une soirée, les accompagner au commissariat pour porter plainte) ou en agissant comme garde-fous vis-à-vis de leurs amis (ne pas défendre un ami accusé de violences sexuelles, par exemple).
Si l’adhésion au féminisme permet de vivre une sexualité plus respectueuse et épanouie aujourd’hui, elle devrait aussi inciter à une réflexion sur les comportements passés.
Cependant, bien que ces hommes se déclarent volontiers prêts à « venir en aide » aux femmes de leur entourage, ils peinent souvent à réexaminer leurs propres comportements problématiques, surtout envers celles avec qui ils ont ou ont eu des relations affectives. Ici, on observe la difficulté de dépasser la « figure repoussoir » de l’agresseur, bien qu’ils reconnaissent que chaque homme est socialisé dans une culture patriarcale et sexiste. Si l’adhésion au féminisme permet de vivre une sexualité plus respectueuse et épanouie aujourd’hui, elle devrait aussi inciter à une réflexion sur les comportements passés. Admettre ses erreurs n’est-il pas un premier pas vers des relations plus saines ?
De la performance au plaisir partagé : vers une nouvelle conception de sa masculinité ?
L’adhésion aux idées féministes amène certains jeunes hommes à reconsidérer la question de la performance sexuelle au profit d’un plaisir partagé et d’une communication sincère. Ces hommes découvrent l’importance de l’écoute mutuelle et du consentement dans le cadre de leurs relations. Ce « désir de réciprocité » permet d’établir des limites claires, redéfinissant la question du consentement au sein du couple. Toutefois, ce désir de réciprocité peut aussi être ambigu : il peut en effet servir inconsciemment à maintenir un rapport de performance sous couvert d’une communication exemplaire. En effet, certains jeunes hommes vont demander si leur partenaire a apprécié le rapport sexuel, moins pour s’enquérir du ressenti de la compagne que sur leur capacité à être de bons amants.
Déconstruire son idéal de performance ne revient pas uniquement à clamer haut et fort que l’on comprend ce qu’est le consentement.
Clément, un jeune homme interrogé, qui semble tout à fait informé sur les questions de consentement et de sexualité féministe, dit avoir une fois dépassé la limite avec sa compagne actuelle. Ayant suivi le « script habituel » de leurs rapports sexuels, il a mis un certain nombre de minutes avant de se rendre compte que quelque chose n’allait pas, « mais deux minutes passées, c’est déjà trop », dit-il. Suite à cette expérience, tous deux ont décidé que le consentement au sein de leur couple devait être formulé oralement. Elle et lui ont également remis en question leur « script sexuel » : ne re posait-il pas sur une démonstration de performance de la part de Clément ? La socialisation des hommes à la sexualité, souvent basée sur un rapport entre dominant et dominé, exacerbée par les normes de genre dans un contexte hétérosexuel, ne mènerait-elle pas à un plus grand risque de violence ? Dorénavant, Clément s’assure également du ressenti de sa compagne après chaque rapport : « C’est pas une question de performance pour savoir ‘’est-ce que je l’ai bien baisée ou pas ?’’. Non, c’est plus pour savoir, est ce que t’as kiffé aussi ? Qu’est-ce qui a été, qu’est-ce qui n’a pas été ? Qu’est-ce qu’on peut changer si jamais les trucs n’ont pas été ? »5 Cet exemple montre qu’aussi proféministe soit-il, l’éventualité d’une violence sexuelle dans le couple est toujours possible.
Or, déconstruire son idéal de performance, auquel les hommes sont si attachés, ne revient pas uniquement à clamer haut et fort que l’on comprend ce qu’est le consentement ou que l’on suit des comptes féministes sur la sexualité sur les réseaux sociaux. Être un homme proféministe signifie une réelle remise en question de ses comportements passés ou présents, à la lumière des pensées et pratiques féministes et notamment du consentement. Réinvestiguer ses erreurs passées, comprendre pourquoi on a com mis de tels actes, même s’il est trop tard pour réparer, permet de mieux appréhender ses actions présentes.
Ainsi, le parcours de ces jeunes hommes montre que l’adhésion au féminisme ne se résume pas à des idées ou à des mots : elle engage un travail sur soi-même, qui vise à aligner les comportements avec les valeurs revendiquées. La question de meure cependant : jusqu’où ces hommes sont-ils prêts à aller pour faire coïncider leurs valeurs féministes et leurs pratiques au quotidien ?