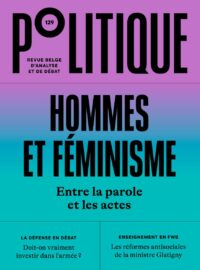Féminisme
La « pillule pour hommes », une panacée féministe ?
08.04.2025

Aujourd’hui, les femmes sont de plus en plus nombreuses à remettre en cause la charge contraceptive. Dans ce contexte, la contraception dite masculine (CM)1 est en expansion et bénéficie d’une médiatisation inédite, bien que son usage demeure encore marginal. Serions-nous en train d’atteindre l’égalité des sexes ? Réflexion d’une sociologue à partir d’entretiens avec des hommes qui ont sauté le pas.
En Belgique et en France, la pilule représente un symbole du droit des femmes à disposer librement de leur corps et la contraception médicalisée a longtemps été étudiée uniquement au prisme de cette vision émancipatrice.
Cependant, la médicalisation de la contraception a induit un déplacement de la responsabilité contraceptive : les méthodes qui nécessitaient une responsabilité masculine ou l’implication des deux partenaires ont été abandonnées au profit de méthodes médicalisées uniquement féminines. À partir de ce fait, les chercheuses Cécile Thomé et Mylène Rouzaud-Cornabas2 proposent d’envisager la maîtrise de sa fécondité comme un travail naturalisé et invisibilisé auquel les femmes ont été assignées.
Causes revendiquées et causes véritables
La chercheuse Joan Tronto3 constate que pour « se charger » d’une tâche de soin, il faut d’abord « s’en soucier ». Le manque d’attention des hommes pour la contraception apparaît clairement dans les discours des hommes interrogés4 : « J’ai été obligé de remarquer que je m’étais quasiment jamais posé la question. » Ce désintérêt s’inscrit dans ce que Joan Tronto appelle « l’irresponsabilité des privilégiés ». Celle-ci permet à certains individus d’ignorer les besoins d’autrui et certaines formes de soin. La contraception étant assignée aux femmes, les hommes ont pu se désintéresser des enjeux contraceptifs. Comment certains en viennent-ils alors à identifier un besoin contraceptif ? Les compagnes des hommes rencontrés avaient souvent vécu des parcours contraceptifs douloureux qui ont mis en lumière le travail contraceptif dont elles étaient responsables. Certaines l’exprimaient parfois explicitement auprès de leur partenaire, l’obligeant à y prêter attention : « Elle me montrait à quel point c’était une charge pour elle, à quel point c’était difficile. Et je voyais tous les jours à quel point c’était une charge. »
Pour « se charger » d’une tâche de soin, il faut d’abord « s’en soucier ».
Si le désir de partager la charge contraceptive est souvent présenté comme la cause du passage à la contraception thermique, c’est généralement une situation d’impasse contraceptive qui les a conduits à modifier leurs pratiques contraceptives. Cette impasse survient lorsqu’une partenaire de longue date a épuisé toutes les options contraceptives féminines ou lors de la mise en couple avec une partenaire qui n’utilise pas de contraception féminine médicalisée. La CM apparaît alors comme une solution de dernier recours pour maintenir une sexualité pénétrative non fécondante et le discours valorisant le partage de la charge contraceptive légitime ensuite cette pratique.
Une contraception soudainement hypervisibilisée
Si l’expérience du travail contraceptif de ces hommes fait en partie écho à celle des femmes, j’ai constaté une différence majeure dans la visibilisation de ce travail. Alors qu’il est naturalisé et invisibilisé quand il est à la charge des femmes, dès lors qu’il est réalisé par des hommes, le travail de maîtrise de la fécondité est hypervisibilisé.
Alors que personne ne songerait à remercier une femme qui se contracepte, lorsqu’un homme s’implique dans le contrôle de sa fécondité et fait plus que ce qui est attendu de lui, son travail « contracepte » apparaît alors comme un « don ».
Le concept d’économie de la gratitude développé par Arlie Russell Hochschild5, socio logue pionnière dans l’étude des émotions, est un outil intéressant pour ana lyser cette différence de perception. La chercheuse s’intéresse aux dynamiques de reconnaissance au sein du couple et propose de considérer un « don » comme ce qui va « au-delà de ce qu’on attend normalement » de quelqu’un et mérite donc de la reconnaissance. Ainsi, alors que personne ne songerait à remercier une femme qui se contracepte, lorsqu’un homme s’implique dans le contrôle de sa fécondité, il fait plus que ce qui est attendu de lui, son travail « contracepte » apparaît alors comme un « don ». Les hommes contraceptés bénéficient de la reconnaissance de leur partenaire – dont ils sont bien conscients, « elle est reconnaissante que j’ai fait ce pas là » – et une partie des usagers en tire une certaine fierté : « C’est cool de soulager le couple de ça aussi. Moi j’en prends un peu, pas d’ego, mais j’en suis un peu fier. »
Un enjeu féministe ?
Alors que la plupart des hommes peuvent se permettre d’ignorer leurs besoins contraceptifs, envisager la contraception comme un travail auquel les femmes sont assignées permet de souligner la dimension politique de cette question et les rapports de pouvoir qui la traversent. En élargissant le panel de choix contraceptifs, la CM répond aux besoins de certaines femmes désireuses de partager le travail de contrôle de la fécondité et peut s’inscrire comme un enjeu féministe. De plus, bien que ce soient souvent des raisons pragmatiques qui aient incité les hommes rencontrés à modifier leurs pratiques contraceptives, la prise de conscience des inégalités liées à la contraception semble avoir éveillé ou renforcé chez eux une sensibilité aux enjeux féministes.
Cependant, la visibilité exacerbée de leur implication dans le travail contraceptif et la gratitude dont ils bénéficient à ce titre peuvent contribuer d’une part à invisibiliser le travail contraceptif féminin et d’autre part à masquer l’investissement des femmes dans le travail contraceptif masculin. Comme le rappelle Elodie Serna6, pour être un enjeu féministe, la CM doit être pensée en lien avec toutes les autres luttes féministes.