Laïcité • Droits humains • Société
Entretien. « La laïcité organisée en Belgique francophone » : défis et réinventions
21.03.2025
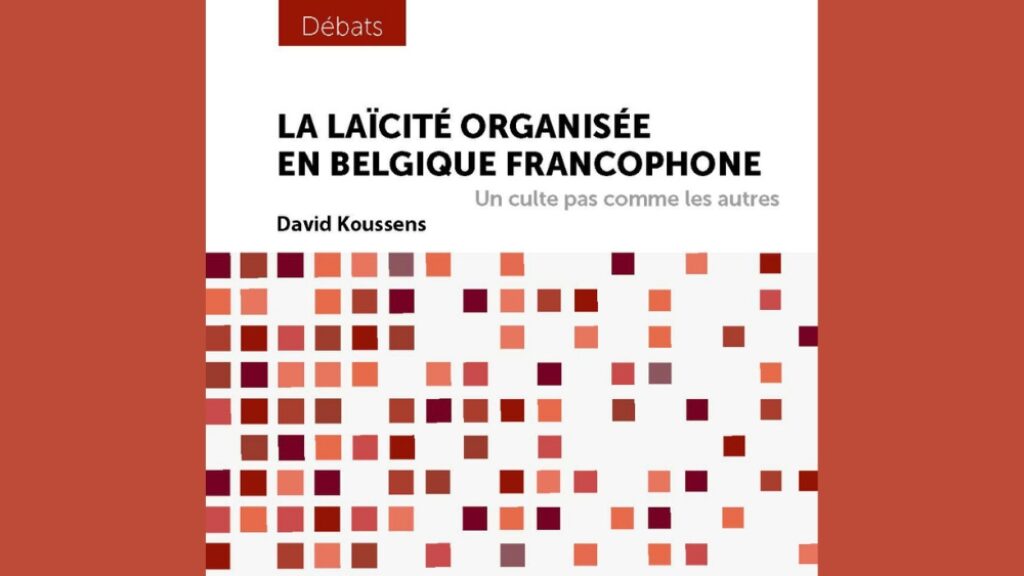
À l’occasion de la parution de son ouvrage La laïcité organisée en Belgique francophone. Un culte pas comme les autres aux Éditions de l’ULB, David Koussens, professeur à l’Université de Sherbrooke, revient sur une spécificité belge : la reconnaissance et le financement public du mouvement laïque, sur un pied d’égalité avec les cultes traditionnels. Dans cet entretien, il explore les paradoxes et les défis auxquels la laïcité belge est confrontée, entre évolution sociale, sécularisation et réinvention nécessaire pour maintenir sa pertinence dans un monde en transformation.
David Koussens, vous êtes en Belgique à l’occasion de la sortie de votre livre consacré à la laïcité organisée en Belgique francophone, sous-titré « Un culte pas comme les autres ». Le pourquoi de ce sous-titre est évident aux yeux des initié·es, c’est-à-dire les laïques de Belgique : il fait allusion à la reconnaissance et au financement public octroyés au mouvement laïque belge depuis plus de 20 ans, selon des modalités réservées jusque-là aux cultes reconnus. Que la laïcité dite organisée soit financée « comme une religion », c’est vraiment une spécificité belge, ça ?
Oui, c’est tout-à-fait particulier à la Belgique. Cela m’a beaucoup étonné, moi, Français et Canadien, de découvrir ce mécanisme ; cela a aiguisé mon intérêt, et in fine c’est ce qui me conduit à publier aujourd’hui ce livre. Je travaillais déjà depuis vingt ans sur la laïcité en tant que principe d’organisation politique de l’État, que l’on peut d’ailleurs observer aujourd’hui dans la plupart des démocraties libérales, même s’il y prend bien sûr des configurations différentes. Être confronté à la réalité laïque belge a donc vraiment bousculé tous les cadres d’analyse en sociologie de la laïcité avec lesquels j’étais familiarisé, car le mot ne renvoie pas à un principe d’organisation mais à un regroupement porteur d’un univers convictionnel très spécifique.
Le mot « laïcité » ne renvoie pas à un principe d’organisation mais à un regroupement porteur d’un univers convictionnel très spécifique.
On peut voir dans le choix de votre sous-titre un rappel de la polémique qui, il y a 30 ans, a opposé le constitutionnaliste Marc Uyttendaele au président du CAL (Centre d’Action Laïque) de l’époque, Philippe Grollet, à propos de l’opportunité d’étendre les mécanismes de reconnaissance et de financement des cultes aux organisations laïques. M. Uyttendaele estimait déplacé que la laïcité soit financée tel un culte, au risque de menacer l’universalité du principe de laïcité et de fragiliser sa défense, alors que P. Grollet tenait un discours plus pragmatique invoquant la nécessité de disposer de moyens pour mener cette lutte en faveur de la laïcité… Trente ans plus tard, la polémique est-elle éteinte ?
Dans la discussion publique, je ne sais pas ; mais ce qui est certain c’est que cette question est au cœur des paradoxes auxquels est confrontée la laïcité organisée et continue de la tirailler de l’interne sur la définition de ce que serait la laïcité.
Grâce à la reconnaissance acquise en 2002, le mouvement laïque dispose de moyens financiers importants – il est la seconde communauté convictionnelle par ordre d’importance du financement reçu, après l’Église catholique (loin derrière elle, bien sûr). Mais cette reconnaissance a une sorte d’effet boomerang : pour s’insérer dans le système des organisations financées, la laïcité a dû progressivement adopter certains traits des organisations cultuelles : par un phénomène d’isomorphisme1, elle a développé une identité convictionnelle, et adopté des rituels et des cérémonies (parrainages et marrainages laïques, fêtes de la jeunesse laïque, mariages laïques, funérailles laïques etc.) pour marquer les grandes étapes de l’existence.
Le mouvement laïque est lui aussi menacé, il lui faut se réinventer pour demeurer pertinent.
Très vite, le mouvement laïque a également été confronté à l’approfondissement de la sécularisation, qui, encore une fois paradoxalement, le touche également. Si les églises se vident de plus en plus, le mouvement laïque, qui est né dans le creuset de l’opposition à l’Église, en quelque sorte en miroir avec elle, se trouve lui aussi menacé : il lui faut se réinventer pour demeurer pertinent. Or, comment demeurer pertinent dans une opposition à une religion qui perd de plus en plus de son poids dans la société ?
La sécularisation de la société a enlevé à l’action laïque une partie de sa raison d’être : l’opposition à la religion.
La laïcité organisée est aujourd’hui confrontée à une époque de vaches grasses et de vaches maigres. En gros, les vaches sont grasses parce que la laïcité est désormais bien financée et dispose des moyens pour déployer ses activités. Mais elles sont maigres aussi, parce que la sécularisation de la société a enlevé à l’action laïque une partie de sa raison d’être (l’opposition à la religion), parce qu’elle a contribué à la dilution du sentiment d’identification à une communauté convictionnelle laïque et affaibli les canaux traditionnels de transmission. Tout cela a provoqué une baisse drastique des demandes qui lui sont adressées sur certains aspects de l’assistance morale qu’elle dispensait, ce qui la contraint à se réinventer. C’est notamment ce qu’elle a fait dans les années 2000 en développant l’assistance morale généraliste pour couvrir tout un ensemble de thématiques sociales – drogues et assuétudes, travail du sexe, intégration des réfugié·es, réinsertion des prisonniers et prisonnières etc – qui peuvent sembler bien éloignées des enjeux laïques traditionnels, mais qui permettent de décliner les valeurs humanistes sur le terrain.
Au fond, il faudrait un pape réactionnaire après François pour réanimer les convictions des laïques…
Il n’est pas besoin d’attendre et le pape François fait déjà bien le travail, car on a beau le qualifier souvent de progressiste, il n’en demeure pas moins le représentant d’une structure conservatrice, surtout sur le plan des valeurs morales. Et on a bien vu que sa visite en Belgique à l’automne 2024 où il qualifié de « meurtrière » la loi dépénalisant partiellement l’avortement a assurément été une excellente occasion pour le mouvement laïque de réaffirmer la légitimité d’un discours anticlérical. C’est à juste titre qu’il a pu clamer haut et fort son opposition aux propos papaux. En ce sens, on pourrait dire que ces derniers ont constitué une aubaine pour le mouvement laïque, oui.
Pour que le Centre d’action laïque prospère, il faut donc que des menaces sur la laïcité soient perceptibles …
Cela aide, oui. À côté de l’Église catholique, le mouvement laïque s’affirme également dans l’opposition à l’Islam qu’il qualifie de politique. Depuis les attentats des années 2010, c’est en effet une préoccupation forte.
À côté de l’Église catholique, le mouvement laïque s’affirme également dans l’opposition à l’Islam qu’il qualifie de politique.
N’est-ce pas plus risqué ? On voit que la laïcité est instrumentalisée par l’extrême-droite, notamment en France … N’y a-t-il pas un risque que la laïcité perde une partie de son âme dans un combat contre l’islam radical ?
Le positionnement à l’égard de l’Islam est en effet plus difficile, car s’il permet de réactiver la nécessité d’un combat contre le cléricalisme, il faut reconnaître que la frontière entre une lutte légitime contre l’obscurantisme religieux et l’islamophobie est parfois mince.
Et donc c’est vrai que l’alter ego par excellence demeure évidemment l’Église catholique, dans des débats qui touchent à l’IVG, l’euthanasie ou l’EVRAS (Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle), par exemple. Il s’agit de thématiques d’autant plus porteuses qu’elles permettent de réactiver des distinctions, voire des conflits, entre les piliers catholique et laïque qui structurent encore la société belge, même s’ils tendent à s’effriter.
La frontière entre une lutte contre l’obscurantisme religieux et l’islamophobie est parfois mince.
Vous écrivez qu’ « en accédant à la reconnaissance et au financement public, la laïcité organisée endosse, à tout le moins implicitement, le principe de financement public des cultes. » Pourrait-on dire que la reconnaissance de la laïcité belge a entraîné un affaiblissement de son combat pour l’instauration d’une laïcité politique ?
Certainement. La laïcité en Belgique est portée par un groupe convictionnel, un entrepreneur de sens laïque, qui défend les intérêts d’une communauté convictionnelle particulière, et qui ne pourrait par conséquent revendiquer la pleine défense du principe politique de laïcité. En bénéficiant elle-même du régime de financement public auquel elle s’opposait, la laïcité a d’ailleurs dû renoncer à un principe cardinal de la laïcité politique, soit celui de séparation des Églises et de l’État, auquel elle a d’ailleurs substitué celui d’impartialité des autorités publiques. Ce qu’elle défend est ici très loin de la laïcité politique comme on l’observe dans les autres contextes nationaux qui ont inscrit ce principe à même leur dispositif législatif ou constitutionnel, et certainement très éloigné d’une laïcité « à la française ».
Ce que la laïcité défend en Belgique est très loin de la laïcité politique comme on l’observe dans d’autres contextes nationaux.
Vous venez comme chercheur canadien porter ce regard extérieur et acéré sur le mouvement laïque. Que pouvez-vous nous dire de la façon dont votre ouvrage est reçu, dans les milieux académiques et auprès du grand public ?
De façon générale, il me semble que ce livre est reçu favorablement, notamment parce qu’il vient combler un manque, assez surprenant du reste, dans le champ des études belges sur la laïcité. Alors même que le mouvement laïque est organisé depuis plus de 55 ans, puis reconnu et financé par l’État depuis plus de 20 ans, quasiment aucune enquête sociologique ne lui a été consacrée ; on ne trouve quasi rien depuis les analyses de Claude Javaux dans les années 1980, et ce alors que les autres groupes convictionnels font l’objet de recherches.
Alors que le mouvement laïque est organisé depuis plus de 55 ans, reconnu et financé par l’État depuis plus de 20 ans, quasiment aucune enquête sociologique ne lui a été consacrée.
Pour le reste, j’ai reçu des réactions contrastées en fonction du public. D’un côté, certain·es ont estimé que mon livre adoptait une perspective laïque et peu critique de mon objet de recherche, probablement parce qu’il était publié aux Éditions de l’Université de Bruxelles, que l’on pourrait apparenter au pilier laïque. Mais d’un autre côté, au sein même de ce pilier, on m’a dit que mon livre était marqué par une perspective chrétienne. Bref, il y a de quoi devenir schizophrène. Quoi qu’il en soit, il faut ici, en tant que chercheur et observateur étranger, prendre un pas de recul. Car cette réception duale est finalement assez révélatrice d’une persistance de la logique des piliers. Ceux-ci s’effritent peut-être, comme je l’ai dit plus tôt, mais on voit qu’ils sont encore bien présents dans certains schèmes de compréhension de la réalité sociale belge, et même si l’on vient de l’étranger.
Propos recueillis par Caroline Sägesser, membre du collectif éditorial de Politique.

