Partis politiques • Politique
Entretien. Les limites du populisme de gauche
15.10.2024
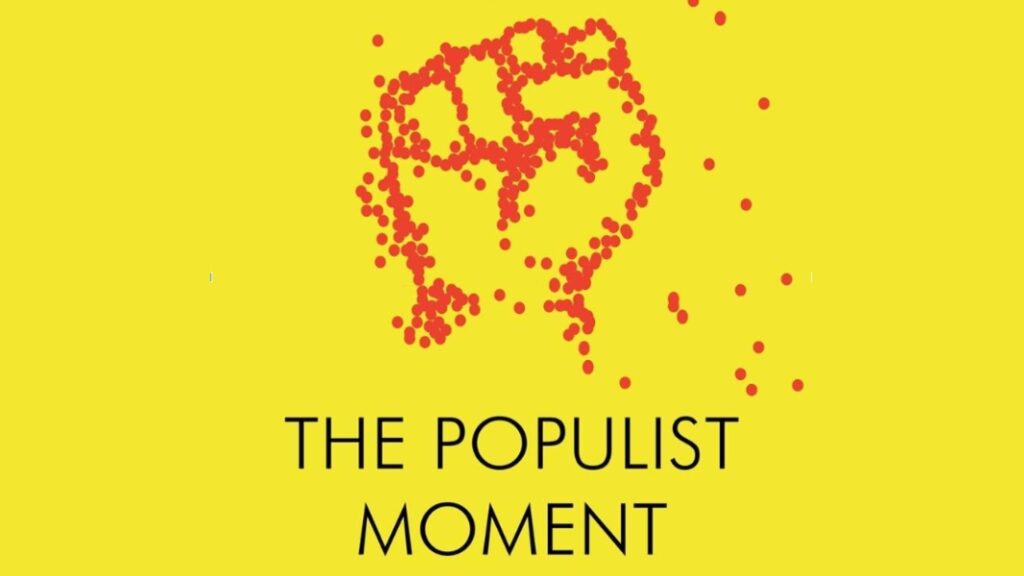
Syriza en Grèce, Podemos en Espagne, Jeremy Corbyn en Angleterre, La France insoumise en France … le populisme de gauche a été le grand événement politique de la décennie 2010 au lendemain de la crise économique de 2008. Comment comprendre ces succès fulgurants, bientôt transformés en échecs ? De quoi parle-t-on, quand on parle de populisme ? La situation politique peut-elle évoluer ? La gauche peut-elle gagner à nouveau ?
Pour en parler, nous nous sommes entretenus avec Arthur Borriello et Anton Jäger, respectivement politologue et historien de la pensée politique, auteurs de Le moment populiste. La gauche après la grande récession chez Verso.
Penser matériellement le populisme de gauche
POLITIQUE Contrairement aux mille et un livres sur le sujet, votre ouvrage n’est pas du tout une dénonciation du populisme…
ANTON JÄGER La question de la définition du populisme est tout sauf triviale. Nous n’avions pas envie de participer aux discours alarmistes, répandus déjà dans les années 2010 – la décennie sur laquelle porte notre ouvrage. Avec Arthur Borriello, nous voulions nous distancier d’une industrie de politologues « antipopulistes», sans tomber pour autant dans l’évangélisme inverse. Pour nous, le populisme n’est pas juste une idéologie ou une disposition psychologique. C’est plutôt une tendance structurelle dans les démocraties modernes, une possibilité latente, mais qui a pris une forme beaucoup plus articulée et explicite ces dernières années.
ARTHUR BORRIELLO Le populisme a une histoire intellectuelle longue et complexe. Ce terme est chargé. Comme Anton vient de le dire, une industrie académique s’est développée autour du terme. Mais en même temps, si une telle industrie existe, c’est parce que l’on a be soin de qualifier quelque chose qui est en train de se produire. Pour le meilleur ou pour le pire, «populisme » est utilisé pour décrire des phénomènes pour lesquels nous manquons de concepts. Face à cela, comme nous l’expliquons dans notre livre, il y a deux attitudes : soit on adopte une sorte de cordon sanitaire sémantique et on refuse ce terme ; soit on essaie de se le réapproprier, de le redéfinir, de le tordre et de réfléchir. Comprendre à la fois le phénomène qu’il est censé désigner et les conditions de possibilité de ce phénomène.
Le populisme de gauche a été intellectualisé et théorisé par Chantal Mouffe et Ernesto Laclau face à un manque, une crise. Est-ce que, au fond, l’enjeu du populisme n’est pas celui de réinventer la démocratie ?
ARTHUR Ce que nous pointons dans l’ouvrage, c’est que, généralement, derrière la critique du populisme, se trouve en effet la critique de la démocratie elle-même, c’est-à-dire l’opposition à la mise en mouvement de revendications collectives, par des groupes de citoyennes et de citoyens, pour l’extension de leurs droits.
Cette catégorisation de populisme finit par englober et mettre sur un même plan Orban et Le Pen d’un côté, Chavez et Iglesias de l’autre. Le soupçon quant aux premiers rejaillit sur les seconds. Et d’une certaine manière, il devient le terme qui permet de disqualifier toute forme de mobilisation collective contre le statu quo, ou l’ordre institutionnel actuel. Il en arrive donc en fait, à dis qualifier la démocratie comme processus, comme ouverture, comme devenir, et non pas comme ordre institué. C’est le plus gros problème avec les usages présents du concept dans le monde académique et médiatique. Nous avons essayé de lutter sur ce point sans tomber dans l’exact opposé, qui serait de dire que le populisme est la solution à tous les maux et d’en faire une espèce de réponse à l’énigme de l’histoire.
Vous évoquez les conditions de possibilité matérielles du populisme au-delà des discours et des attitudes, que voulez-vous dire?
ANTON La question n’est pas simplement celle du système démocratique plus ou moins ouvert. Il y a aussi un rapport plus matérialiste à la question. Celui de la social-démocratie [NDLR : « social-démocratie » ne renvoie pas simplement ici à une tendance politique, mais bien à l’articulation d’un parti et d’un syndicat, intégrés plus ou moins fortement aux institutions d’un pays, et supposés représenter tous deux les intérêts immédiats des travailleurs et des travailleuses], et de sa crise contemporaine. Nous le montrons avec des précédents, les cas américain et russe au XIXe siècle : le sous-développement d’une certaine social-démocratie est essentiel. Cela explique en partie la possibilité ou l’espace ouvert pour une intervention populiste, ces dernières années.
Le populisme et la social-démocratie sont deux manière concurrentes d’essayer de faire la même chose : mobiliser les masses populaires en vue d’une transformation sociale.
ARTHUR S’il y a bien une espèce de constante historique qui permette de comprendre pourquoi le populisme, à un certain moment, devient une ressource, à la fois intellectuelle et politique, cela a toujours quelque chose à voir avec l’absence de social-démocratie, son déclin ou son sous-développement. Le populisme et la social-démocratie sont deux manières concurrentes d’essayer de faire quelque chose d’équivalent, c’est-à-dire : mobiliser les masses populaires en vue d’une transformation sociale. Ainsi, les grands mouvements populistes latino-américains sont ceux qui ont créé les formes d’État social ou d’État providence. Ce sont des équivalents fonctionnels à la social-démocratie européenne.
ANTON …deux réponses différentes à la même question.
ARTHUR Exact ! Je crois que c’est Guido di Tella, ministre sous la présidence de Carlos Menem, qui avait trouvé cette formule : « le péronisme, c’est la social-démocratie que l’Argentine a pu se permettre ! » Mais ce rapport au déclin contemporain de la social-démocratie en Europe n’est jamais posé dans les analyses que j’appellerais « libérales » du populisme. Pourtant, c’est probablement l’élément le plus déterminant.
Derrière la critique du populisme, se trouve souvent la critique de la démocratie elle-même, c’est-à-dire l’opposition à la mise en mouvement de revendications collectives.
Dans le livre de référence Hégémonie et stratégie socialiste, Mouffe et Laclau expliquent que, effectivement, le droit de vote a été obtenu au XXe siècle, ainsi que des droits sociaux et donc, la social-démocratie a réussi. Elle n’aurait plus grand-chose à nous apporter, parce qu’elle n’a pas pensé les questions de genre, écologiques, etc. Est-ce une erreur, selon vous ?
ANTON L’ironie historique, c’est que ce diagnostic a été invalidé. Les droits sociaux, conquis durant le XXe siècle, ont en effet été renversés. Et c’est cela qui explique partiellement maintenant le succès du populisme de gauche. Au début, Chantal Mouffe avait conçu le populisme de gauche comme une sorte d’extension d’une social-démocratie victime de son propre succès. Et à la fin, on voit que non : le populisme est un peu devenu la social-démocratie sans la social-démocratie. C’est aussi l’historique de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi commence-t-il à lire Chantal Mouffe à un moment donné ? Pourquoi commence-t-il à parler du peuple, et pas de la classe ou de la gauche au milieu des années 2010 ? Ça a à voir avec une condition structurelle qui n’était pas là auparavant.
Quels changements se produisent vers 2010 ?
ARTHUR Du point de vue structurel, il y a un double fait. C’est à la fois la structure de classe de la société qui est complètement éclatée par rapport à ce qu’elle était, ce qui change complètement la question de l’organisation et de la reconnaissance idéologique pour les partis de gauche. Mais il y a, en plus, le fait que les groupes sociaux eux-mêmes se reconnaissent de moins en moins comme des groupes sociaux, avec des intérêts et des valeurs communes. Ce double processus s’est profondément accéléré au moment de la crise de 2008, mais couvait déjà depuis la fin des années 1960, débuts des années 1970, avec le changement de la structure économique des sociétés européennes, mais aussi l’arrivée d’un ensemble de questions plus symboliques, liées aux valeurs sociales.
ANTON En effet, et ce n’est pas comme si la science politique classique n’avait rien à dire sur ce sujet. Mais ses analyses restent très peu matérialistes. L’économie politique est totalement évacuée.
Justement, la Belgique ne fait rien comme les autres, c’est connu, également en matière d’économie. Les Français ou les Néerlandais sont très étonnés quand on leur explique qu’il y a toujours, dans notre pays, l’indexation automatique des salaires. On peut remarquer qu’il y a encore ce qu’on appelle, en termes libéraux, « une société civile organisée ». Si, comme vous le dites, il existe une sorte de mouvement de balancier entre la social-démocratie et le populisme, la Belgique est-elle prémunie du populisme, car la social-démocratie y est encore présente ?
ARTHUR Je suis assez d’accord avec ce diagnostic. L’état de délitement des clivages historiques et de la société civile organisée est beaucoup moins avancé que dans d’autres pays d’Europe. Il n’y a donc pas de populisme au sens strict. Mais il faut voir les conditions du populisme comme un continuum. L’Italie serait l’exact opposé, du fait de l’écroulement soudain des clivages au début des années 1990. Les grands piliers qui organisaient la vie sociale et politique, le Parti communiste (PCI) et la Démocratie chrétienne s’effondrent en même temps. Ce cimetière de partis politiques, c’est ce que des politologues ont appelé un « paradis des populismes ». Ce sont des conditions structurelles parfaites pour l’émergence d’un populisme.
Si l’on prend la Belgique, qui est à l’opposé, les clivages historiques tendent à décliner, mais il y a une forme de résilience et de résistance plus fortes qu’ailleurs, en raison du degré d’institutionnalisation des clivages dans des « piliers » (NDLR : mutuelles, syndicats, associations, partis, groupes divers forment des ensembles organisés en Belgique, que l’on nomme « piliers », en s’inspirant du vocabulaire employé aux Pays-Bas). Par conséquent, ça n’est pas un hasard, sans doute, si les « nouveaux acteurs » de la scène politique belge ont plutôt réinvesti les clivages, que nié leur existence ou tenté leur dépassement. Ainsi, le PTB-PVDA propose de réactiver le clivage gauche-droite, de le réinvestir avec une stratégie à la fois communicationnelle et organisationnelle.
ANTON Je suis d’accord. Mais il y a quand même une hybridité politique, même dans la culture politique belge. Si l’on écoute le discours du PTB, ce n’est pas du tout le décalogue des années 1970 et 1980, avec un discours de classe très doctrinal. Du côté flamand, c’est très clair. La suspicion anticommuniste est beaucoup plus forte qu’en Wallonie. On y parle donc avant tout des « mensen », des « gens» (NDLR : « Les gens d’abord, pas le profit »). Évidemment il s’agit de termes d’une généralité beaucoup plus grande que le discours de classe marxiste traditionnel.
ARTHUR Il y a aussi, il est vrai, des différences entre la Wallonie et la Flandre. Ce n’est probablement pas un hasard si cet espèce de tournant désidéologisant de la social-démocratie est pris par les socialistes flamands du Vooruit, avec leur changement de nom récent, notamment, contrairement au Parti socialiste (PS) francophone. Cela offre une forme de confirmation de l’importance des facteurs structurels, de conditions de possibilité dans l’émergence de phénomènes populistes.
Le moment populiste est un moment de mobilisation dans un contexte de désorganisation majeure. Ce qu’on observe maintenant, c’est plutôt une forme d’apathie et d’indifférence généralisée.
La social-démocratie a pourtant été institutionnalisée partout en Belgique. Alors, comment expliquer l’effondrement beaucoup plus grand de cette social-démocratie, ou même du pilier chrétien, en Flandre, par rapport à la situation wallonne ?
ANTON Je crois qu’il y a quand même eu deux formes d’industrialisation différentes. La Flandre s’est industrialisée dans les années 1960 et 1970 sur un modèle quasi-américain, et non pas sur le modèle paléo-industriel du XVIIIe siècle. Elle l’a fait avec un modèle d’urbanisation amplement différent, avec une économie totalement différente. Le pilier socialiste en Wallonie a été construit sur des citadelles urbaines industrielles, Liège, Charleroi… qui ont changé, mais qui sont encore là, en un sens résiduel. En Flandre, il y avait évidemment une social-démocratie à Gand et à Anvers, liée à une industrie, mais l’industrialisation de la Flandre, au milieu du vingtième siècle, n’a pas pris la même forme.
Réalités du populisme de gauche
Après les premières conquêtes électorales et d’appareils politiques, il semble que les mouvements populistes aient échoué partout en Europe. On rêvait d’un Chavez en France, et l’on se retrouve avec Jean-Luc Mélenchon qui crie à des policiers : « La République c’est moi ». Faut-il y voir l’échec d’intellectuels qui ont voulu prendre le pouvoir sans une organisation politique traditionnelle ?
ANTON Je pourrais répondre en une phrase : le problème, c’est que la source de succès du populisme de gauche est aussi l’origine de ses limites. Le populisme de gauche existe à cause d’une crise de la social-démocratie, mais en même temps, il ne peut dépasser l’imaginaire de cette crise. C’est circulaire : la désorganisation du monde social offre des chances ou des occasions à des populistes de gauche, mais en même temps, cette crise fait que les partis restent faibles sur le plan organisationnel, et c’est cela qui explique qu’il y ait un moment populiste. C’est pour cela que nous parlons d’un « moment populiste » avant tout. Au contraire, on peut difficilement parler d’un « moment chrétien-démocrate », ou d’un « moment communiste » – à part peut-être en un sens révolutionnaire. L’idée de continuité, liée à ces traditions politiques, n’existe pas vraiment pour l’hypothèse du populisme de gauche.
ARTHUR La comparaison avec l’Amérique latine est précisément aussi ce qui a induit en erreur un certain nombre d’intellectuels, en particulier à Podemos, en surestimant la « latino-américanisation » du continent européen. Ce qui a voulu dire surestimer le degré de fluidité du jeu politique. La conjoncture était beaucoup plus limitée dans le temps que ce que l’on se figurait.
ANTON En un sens, le jeu politique était vide, mais pas assez.
ARTHUR Si l’on regarde en Espagne, le gros problème a été le fait que, effectivement, la latinoaméricanisation avait été surestimée. Podemos n’a pas vu venir l’irruption de nouveaux acteurs, qui ont bouché une partie du champ politique, mais surtout la capacité de résilience des appareils de partis traditionnels et en particulier du parti socialiste espagnol, qui a montré une solidité absolument incroyable et une force d’adaptation stratégique qui force le respect. La manière dont Sanchez a géré cette situation, c’est un manuel de survie politique que tout socialiste ou social-démocrate devrait lire ! L’hypothèse populiste que Podemos posait était qu’il y avait un tel degré de fluidité des allégeances politiques, que l’on allait réussir à bâtir un nouveau bloc majoritaire, en représentant une force transversale et dépassant cette logique gauche-droite. En fait, malgré lui, le parti a été ramené à cette logique, ainsi qu’à celle de l’opposition centre-périphérie, qui sont, en Espagne, extrêmement contraignantes. Podemos est donc redevenu une gauche radicale comme une autre.
Doit-on attendre une suite de cet ouvrage, un deuxième volume traitant cette fois-ci de la décennie 2020 ? A-t-on quitté la phase populiste pour entrer dans une nouvelle période ?
ANTON En Allemagne, Sahra Wagenknecht souffre déjà des mêmes ambiguïtés et limites que nous soulignons dans notre ouvrage. Cependant, j’ai le sentiment que nous ne vivons plus dans ce moment des années 2010 liées à la crise économique de 2008. La condition structurelle que nous décrivons ne s’est pas affaiblie. La désorganisation s’est accélérée en de nombreux aspects. Mais ce que l’on constate maintenant, c’est qu’il est encore plus difficile d’imaginer ou de penser l’institution d’un nouveau parti.
Ce que l’on constate maintenant, c’est qu’il est encore plus difficile d’imaginer ou de penser l’institution d’un nouveau parti.
ARTHUR Je suis d’accord. Les conditions structurelles sont toujours présentes, mais il n’y a pas l’étincelle de la crise de 2008. Si une nouvelle mobilisation se produisait, il est donc probable qu’une forme de grammaire populiste reprendrait à nouveau, hormis un changement majeur dans la structure de nos sociétés. Mais je n’ai pas l’impression que le temps soit à cela, compte tenu les signaux de cette nouvelle décennie déjà bien avancée
Oui, car le moment populiste exige aussi des conditions plus « conjoncturelles »…
ARTHUR Le moment populiste est un moment de mobilisation dans un contexte de désorganisation majeure. Ce qu’on observe maintenant, c’est plutôt une forme d’apathie et d’indifférence généralisée, qui est aussi malheureusement une conséquence indésirée du cycle populiste de gauche. Cela a créé un certain nombre de déceptions qui font qu’aujourd’hui, il est très difficile d’imaginer de retourner à une expérience politique de ce type. Par ailleurs, tous ces mouvements, d’une façon ou d’une autre, se sont quand même sédimentés, institutionnalisés. Ils occupent donc un espace dans le champ politique. Ce champ n’est donc plus un « espace vide ». La France insoumise (LFI) a réussi cette opération de réoccuper un espace de gauche authentique dans le paysage politique français.
ANTON Avec un électorat qui n’est pas l’électorat que la coalition mélenchoniste voulait construire au début, celui des votes FN et une certaine section de la société démobilisée. Mélenchon en fait, se retrouve à la tête d’une coalition qui, en beaucoup de sens, retrouve celle de Hollande.
Je reviens sur l’ironie qui imprègne votre livre…
ARTHUR Ironiquement, en effet, la plupart de ces partis ont raté les objectifs qu’ils affichaient et ils ont atteint ceux qu’ils répudiaient. Ils voulaient « tuer la gauche », ils l’ont fait renaître. L’ambition était de créer une vaste coalition transversale qui va de l’ancienne classe industrielle aux zones rurales, à un électorat urbain. C’est raté. En revanche, pour l’électorat urbain, c’est une grande réussite chez LFI, qui a réussi à coaliser des classes populaires urbaines de manière assez spectaculaire. L’électorat de Podemos ressemblait également à cela.
Bienvenue dans l’hyperpolitique
Cela nous ramène à la question de la classe ouvrière. Elle semblerait ou se sentirait abandonnée par la gauche. Que faire face au mélange contemporain d’apathie sociale et de surpolitisation atomisée, que vous appelez, Anton Jäger, « hyperpolitique » ? Comment fait-on pour dépasser le moment populiste s’il est voué à l’échec ?
ANTON Le populisme de gauche est malheureusement marqué par un désintérêt ou même, je dirais, une indifférence, à la sociologie. Quels sont les bases matérielles ou les intérêts latents dans la société ? Une sociologie sur laquelle on puisse construire cette coalition populiste. Mais le message du livre consiste aussi à dire que les opposants à cette hypothèse populiste, à gauche, n’ont pas non plus d’alternatives très convaincantes à ce nouveau programme. C’est ce qui explique, avec Arthur, notre ambiguïté vivace pour le populisme. Une partie de la gauche a cru, en fait, que la désillusion, le grand désengagement des années 1990 et 2000, pouvait être une source de repolitisation, voire un moment révolutionnaire. Ils ont cru que le désengagement de la population vis-à-vis des partis traditionnels signifiait que les gens se repolitiseraient ailleurs. En réalité, cela a signifié une retraite de la sphère publique en général. Mais il y a une sorte d’impatience révolutionnaire que l’on voit dans l’ultra gauche, complémentaire à l’obsession hyperpolitique de certaines personnes.
ARTHUR Ce que le concept d’hyperpolitique, tel qu’Anton le discute, apporte de nouveau, c’est qu’il n’y a même plus la projection institutionnelle électorale, c’est juste une politisation éphémère. Vide à la fois de toute ambition et de prise de pouvoir. Et ne parlons même pas de l’ambition organisationnelle de pérennisation, dans le temps long, qui était déjà un problème massif du populisme de gauche.
ANTON Comme le disait Kautsky, avant la Première Guerre mondiale : « il nous faut une stratégie de patience ». Le travail politique ne se fait pas en deux ou trois années, c’est un travail qui se compte en décennies. Et peut-être, si une occasion bienvenue se présente, y aura-t-il alors la possibilité de réaliser vraiment une transformation de la société.
Une partie des lecteurs et des lectrices sont des militants et militantes, qui veulent changer les choses maintenant. Sont-ils dans l’hyperpolitique ? Notre revue devrait-elle se renommer « hyperpolitique » pour cadre avec l’époque ?
ANTON L’hyperpolitique est un modus d’engagement politique qui n’est ni celui de la politique de masse ni celui de la post-politique. Il n’est pas celui de la post-politique, qui consiste en un désengagement de la sphère publique. Au contraire, son point commun avec la politique de masse, c’est une forme d’engagement qui participe à une dynamique publique fortement politisante. Mais en même temps, l’hyperpolitique n’implique pas vraiment des institutions ou des affiliations durables, avec des acteurs politiques concrets.
Si les gens se retrouvent dans des partis ou des institutions, ils ont un sens de l’engagement qui est plus durable.
Est-ce que vous souhaitez passer un message à ces lecteurs et lectrices, qui sont peut-être, sans le savoir, dans une forme d’hyperpolitique ?
ANTON S’ils se retrouvent dans des partis ou des institutions, ils ont un sens de l’engagement qui est plus durable. Il ne s’agit donc pas d’un engagement « hyperpolitique ». Mais si nous regardons ce que fait Georges-Louis Bouchez, c’est un exemple très clair. Il s’agit de quelqu’un qui veut conduire une politique sur le court terme. Il n’y a pas un grand projet sur le temps long, pour vraiment affilier les gens à un mouvement et les mobiliser durablement.
ARTHUR On pourrait considérer que l’ère de la politique de masse, c’est la socialisation avec la politisation. L’ère de la post-politique, c’est la socialisation sans la politisation. Et l’hyperpolitique, c’est l’inverse : la politisation sans la socialisation. Une politisation qui est éphémère, spectaculaire, dans le temps court. À l’exemple du mouvement « Black Lives Matter » aux États-Unis. Mobilisation de masse extraordinaire en termes numériques, mais qui ne donne rien en termes d’organisation sur le long terme, de création d’infrastructures, etc. Il en va de même avec les gilets jaunes. Que reste-t-il de ce mouvement incroyable du point de vue de l’organisation concrète ?
ANTON On le voit même avec les manifestations pour la Palestine aujourd’hui. Dans plusieurs pays, une masse énorme de gens descend dans les rues, pour une cause qui est manifestement urgente. Mais il y a très peu de cristallisation de ces engagements dans des organisations concrètes.
ARTHUR Ce qu’on voudrait dire à des activistes, pour répondre à la question ? Eh bien, au début des années 2000, il y avait le titre de ce livre de Stéphane Hessel, « indignez-vous ». Aujourd’hui, il faut lancer cet appel : « organisez-vous ! »
Propos recueillis par Martin Georges.


