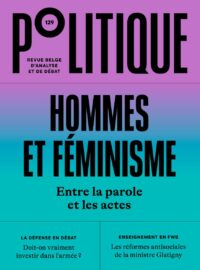Féminisme • Politique
Entretien. Les hommes dans les combats féministes, selon Francis Dupuis-Déri
08.04.2025
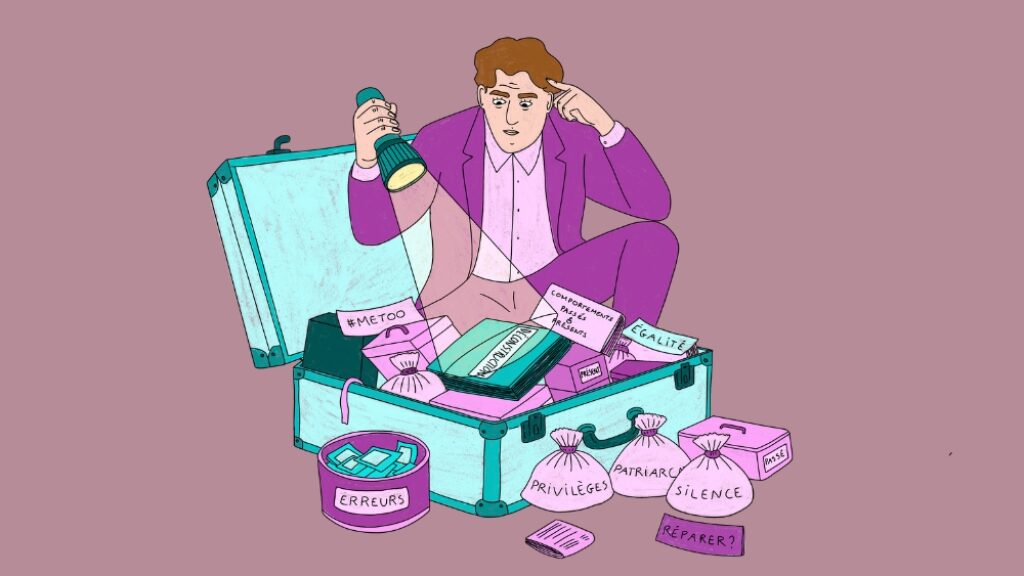
En Belgique comme ailleurs, les hommes et les organisations progressistes ont souvent joué un rôle ambigu dans les luttes féministes, entre soutien, relégation, voire silenciation. Aujourd’hui, il ne semble toujours pas aller de soi, pour un homme, de se déclarer féministe, et pour ceux qui s’affirment comme tels, le chemin est parfois plus compliqué qu’il n’y paraît.
POLITIQUE Malgré les avancées féministes, certain·es à gauche considèrent encore le féminisme et le racisme comme secondaires par rapport à la lutte anticapitaliste. Qu’en penses-tu ?
FRANCIS DUPUIS-DÉRI Il y a effectivement une suspicion qui continue à circuler. Je pense notamment à l’argument ridicule, mais qui semble imparable : « Vous voyez, même les grandes firmes multinationales intègrent des politiques anti-discrimination, d’équité, de diversité et d’inclusion, ce n’est donc pas révolutionnaire ». C’est ce qu’on appelle en Amérique du Nord, les « politiques des identités », identity politics en anglais, et c’est ce que Donald Trump et Elon Musk s’efforcent d’éliminer dans l’appareil fédéral en ce moment, sous prétexte que cela contrevient au principe de la compétence et du mérite. C’est faux, évidemment, puisqu’il y a aussi le principe « à compétence égale ». De plus, Trump et les membres de son équipe sont certainement mal placés pour vanter le principe de la compétence.
Si on considère que l’égalité est un principe central de l’engagement à gauche, on doit être révolté par les inégalités qui désavantagent les femmes, dans la vie publique ou privée.
Une partie de la gauche affirme que le capitalisme récupère et recycle ainsi ces questions : le racisme, la diversité de genre, des sexualités. Le féminisme ne serait donc pas révolutionnaire, ni l’antiracisme. En fait, c’est une reprise d’un vieux discours du XIXe siècle critiquant le « féminisme bourgeois », qui se désintéresse des questions sociales, de « vrais enjeux » qui touchent davantage la classe ouvrière, les milieux populaires, ou maintenant la classe moyenne qui aurait été abandonnée par la gauche et se retournerait donc vers l’extrême droite. Il y a encore aujourd’hui ce type de discours que le féminisme est étranger d’une certaine manière à la matrice socialiste, car libérale et individualiste. Mais à ce compte, il faudrait aussi abandonner le syndicalisme, puisque le capitalisme l’a aussi intégré, comme à peu près tout le reste…
POL Comment inciter les hommes qui se pensent progressistes à s’impliquer en faveur du féminisme ?
FDD Si on considère que l’égalité est un principe central de l’engagement à gauche, on doit être révolté par les inégalités qui désavantagent les femmes, que ce soit dans la vie publique ou la vie privée, dans les organisations, les syndicats ou les groupes militants. Dans le système libéral, si vous avez moins d’argent, vous avez moins de liberté, moins d’accès à la propriété, moins de choix de vie et une plus faible pension. Les chiffres montrent que les femmes sont plus pauvres quand elles sont au chômage et lorsqu’elles atteignent la retraite, car elles ont moins de salaire. Mais en plus de l’argent, il y a toutes les autres formes d’inégalités. C’est bien documenté. Les hommes parlent plus que les femmes dans les organisations politiques, dans les couples et dans les situations de mixité. Le temps libre, le travail gratuit, toutes ces questions sont des enjeux qui touchent le travail aussi. Ça devrait donc s’inscrire dans une logique de gauche.
Il est essentiel que les hommes assument leur part de responsabilités, ça implique de faire des efforts continus et de changer les pratiques quotidiennes.
POL Tu insistes sur le fait qu’être un homme proféministe relève de pratiques quotidiennes et d’un travail continu… comment ça s’incarne ?
FDD La première chose c’est se taire, écouter, s’éduquer, accepter la critique et s’engager dans une réflexion auto critique, plutôt que de se braquer, de contre-attaquer avec les premiers arguments qui nous viennent à l’esprit. Atteindre l’égalité dans le travail, y compris le travail gratuit, est une tâche complexe. Même les féministes radicales, malgré leur compréhension du patriarcat et du sexisme, se retrouvent souvent à s’occuper de leurs proches, car leurs frères ne le font pas. Il est essentiel que les hommes prennent conscience de cette réalité et assument leur part de responsabilités, afin d’alléger celle des femmes. Cela implique de faire des efforts continus et de changer les pratiques quotidiennes, tant dans la vie privée que dans les relations amicales et amoureuses. C’est à nous, les hommes, de nous impliquer activement et de ne pas laisser ces tâches être considérées uniquement comme des responsabilités féminines. Il est essentiel d’être solidaires des femmes qui se battent, y compris dans des contextes compliqués, comme en cas de harcèlement et d’agressions sexuelles, et dans les organisations.
POL Dans ton livre Les hommes et le féminisme : faux amis, poseurs ou alliés ? , tu remarques que des hommes s’engagent en tant que proféministes, mais peuvent poser problème. De quelle façon ?
FDD Dans leurs études sur des expériences militantes, les trois sociologues, Julie Taylor, Mélissa Blais et Christine Delphy1 arrivent au même constat avec des études très différentes : les hommes qui se disent de gauche, solidaires des féministes, vont se placer en avant dans les manifestations, scander les slogans plus fort, garder le porte-voix. Ils vont réagir négativement et insulter des féministes lorsqu’elles demandent qu’ils leur laissent plus de place dans la rue, qu’ils marchent un peu plus en retrait ou ne scandent pas les slogans à leur place. Il y a aussi la manière dont ces hommes vont distinguer les bonnes des mauvaises féministes. Ou encore, la façon de se faire féliciter à chaque instant, pour une prise de position qui sera jugée courageuse, jusqu’aux tâches les plus banales. À chaque fois, ce sont des injustices symboliques, mais qui sont liées au pouvoir.
Souvent, les hommes de gauche priorisent d’autres luttes, reléguant les enjeux féministes au second plan.
Dans les organisations militantes, qu’elles soient focalisées ou non sur le féminisme, il est crucial de savoir si les hommes proféministes permettent aux femmes de décider elles-mêmes de leurs objectifs, des priorités et tactiques. De façon plus générale, souvent, les hommes de gauche priorisent d’autres luttes, comme les campagnes électorales ou d’autres mobilisations sociales, reléguant les enjeux féministes au second plan. Cette tendance historique, au sein de la gauche, est problématique, tout comme le refus de la non-mixité.
POL Que permet cette non-mixité ?
FDD La non-mixité est un principe super simple et pas difficile à comprendre, en principe, si l’on est de gauche. Je donne souvent l’exemple des syndicats. Les travailleurs et travailleuses se réunissent pour penser à leurs stratégies, à leurs conditions, à leurs priorités ou à leurs revendications. Ça leur donne de la force, pour retourner négocier avec le patron. La non-mixité, c’est la même logique. L’objectif est d’aider à développer des rapports de force. Évidemment, il y a quelque chose qui peut être inquiétant, si on a des choses à se reprocher. Mais c’est tout à fait logique qu’il y ait des collectifs non mixtes entre femmes. Et les féministes sont d’ailleurs le plus souvent en mixité, dans plein d’autres occasions, y compris dans leur vie privée.
Le principe de non-mixité est super simple et facile à comprendre, en principe, si l’on est de gauche.
POL Comment est-ce apparu ?
FDD À partir des années 1960-70 émerge le féminisme radical, un terme qu’on utilise moins maintenant. Aux États-Unis, des militantes d’extrême gauche, afro-américaines, dans des perspectives révolutionnaires, souvent marxistes-léninistes (on pense notamment à Angela Davis) étaient engagées dans des collectifs, et de là est né le féminisme radical. C’est-à-dire que c’était tellement pénible pour elles de militer avec leurs camarades masculins, qu’elles ont dû créer des groupes en non-mixité ! Elles n’ont pas commencé comme ça, et n’étaient souvent même pas féministes au début. Mais elles ont fini en non-mixité, en tant que féministes radicales, à cause du machisme de leurs camarades de gauche et d’extrême gauche.
POL On entend parfois des discours à gauche du type : « On ne sait plus comment agir, on ne sait plus comment dire les choses, et cetera ». Que réponds-tu à ça ?
FDD Je dis surtout aux gens de lire. Si vous n’aimez pas lire, trouvez autre chose. J’étais libraire à la fin des années 1980 dans une librairie générale. Pendant des mois et des saisons, on ne pouvait avoir aucun livre féministe qui arrivait sur les rayons. Il n’y avait que Simone de Beauvoir, qui traînait quelque part. Il n’y avait pas grand-chose non plus sur la gauche et l’extrême gauche, par ailleurs. Mais en féminisme, il n’y avait vraiment rien. Et aujourd’hui, vous entrez dans n’importe quelle librairie, il y a des publications sur diverses thématiques. Et si vous n’aimez pas lire des livres, il y a des revues, des bandes dessinées, des vidéos, des podcasts. Il y a des colleuses en Belgique, donc aussi des réflexions sur les murs.
S’éduquer vraiment, plutôt que de croire tout savoir sur tout, c’est toujours un bon début.
La première chose à faire c’est de s’informer, c’est comme pour les autres sujets. Quand il y a eu Black Live Matters en Amérique du Nord, des collègues sont allé·es à la bibliothèque et ont commencé à lire, parce qu’iels n’avaient pas été formé·es sur le racisme et l’antiracisme. Et en ce moment, il y a des gens qui lisent sur la Palestine, parce qu’ils n’y connaissaient rien. S’éduquer vraiment, plutôt que de croire tout savoir sur tout, c’est toujours un bon début.
POL Les hommes de gauche qui se disent proféministes peuvent dire qu’ils ont tout lu, ce qui leur confère un certain prestige. Cependant, au sein de la gauche, on observe encore des comportements problématiques, allant de propos sexistes aux violences sexuelles.
FDD C’est ce que des Américaines et Canadiennes avaient nommé « les poseurs » ou « les initiés ». Une fois que les hommes commencent à lire, très rapidement, ils ont des idées géniales auxquelles les féministes — pense-t-on — n’auraient jamais pensé (rires) ! Cela touche à la socialisation masculine. Quelque chose de très commun pour des hommes proféministes qui ont lu, sera d’avoir une discussion avec des femmes qui disent qu’elles ont subi des violences sexistes ou sexuelles. Après deux minutes, l’homme va les interrompre, leur parler de ce qu’il a lu sur le sujet et même leur fournir des références : « Oui, j’ai lu un truc super intéressant sur les violences sexuelles, c’est comme ça aussi au Mozambique ou au Congo. » C’est ce qu’on appelle, dans une perspective critique, la position du poseur ou de l’initié. C’est celui qui prend la pose du pro féministe, qui connaît éventuellement des théories, ou en tout cas qui va être au rassemblement du 8 mars, et qui peut faire la leçon aux féministes. Il peut même avoir des comportements plus problématiques, surtout s’il s’aperçoit qu’il devient charmant et sympathique aux yeux de féministes.
C’est commun chez des hommes proféministes qui ont lu : ils ont une discussion avec des femmes qui disent qu’elles ont subi des violences sexistes et sexuelles, il va les interrompre pour leur parler de ce qu’il a lu sur le sujet.
POL Selon toi, les hommes doivent donc se responsabiliser par un effort de transformation personnelle. Cependant, n’y a-t-il pas un risque, celui de se focaliser sur une perspective individuelle, où chaque homme doit décider de changer ? Ne doit-on pas adopter une perspective structurelle, engageant la société entière dans cette responsabilisation ?
FDD Je comprends l’enjeu… Si l’on prend la cause environnementale ou écologiste, ce n’est pas en commençant à composter chacun chez soi que nous sauverons la planète. Néanmoins, la cause féministe est particulièrement imbriquée avec les comportements individuels. Je ne dirais pas pour autant que c’est une lutte individualiste, mais par exemple, généralement, les hommes ont une famille et une mère. Ce qui amène nécessairement, je pense, des réflexions sur les comportements individuels dans nos relations avec des femmes. Si on est un homme, hétéro sexuel, en couple, on est en cohabitation avec notre conjointe, 365 jours par an. Donc l’engagement est continu. Il est difficile de se désincarner de l’individualisme : les féministes reprochent d’ailleurs à des hommes, dans leur individualité, de ne pas être à la hauteur de ce qu’ils prétendent être dans leurs discours. Même au niveau individuel, ça fonctionne peu sans rapport de force de la conjointe, de l’amie, de la colocataire ou de la sœur, car les hommes, quand il n’y a pas de rapport de force, sont nettement moins motivés. Ils ont souvent des coups de mou et des bonnes excuses. Et donc c’est individuel, mais aussi, et surtout, relationnel.
Il est difficile de se désincarner de l’individualisme : les féministes reprochent à des hommes, dans leur individualité, de ne pas être à la hauteur de ce qu’ils prétendent être dans leurs discours.
POL Que remarque-t-on dans l’observation de ces couples ?
FDD La politiste québécoise Stéphanie Mayer montre que les conflits dans les couples hétérosexuels sont logiques, puisqu’ils sont souvent inégalitaires, comme le démontrent encore et toujours les études sociologiques. Si les couples étaient égalitaires, il y aurait moins de conflits. Les critiques masculinistes prétendent que les femmes sont trop souvent initiatrices des divorces, et ne sont donc pas gentilles avec les hommes, plutôt que de se demander pourquoi les femmes devraient accepter des relations qui les désavantagent. Tout cela reflète des positions et des dynamiques individuelles, mais aussi relationnelles et sociales. Après ça, on revient à du collectif et aux organisations de gauche, et à ce que les hommes peuvent faire. Et là, ils peuvent faire plusieurs choses : soutenir les propositions que les femmes vont communiquer, s’assurer que les prises de parole soient égalitaires et essayer de se mobiliser sur différentes causes.
POL Les inégalités sont multiples dans notre société. Comment penser un engagement féministe des hommes dans une démarche intersectionnelle, en intégrant à la fois le genre, la classe, la religion… ? Est-ce que tu as des exemples où cela a fonctionné et qui la prennent en compte ?
FDD bell Hooks, Angela Davis, Michael Wallace, Frances Beal et d’autres afro féministes des années 1960-70 aux États Unis donnent des pistes pour penser de manière plus englobante. Au Canada, Joyce Green, une femme autochtone, aborde les violences sexuelles dans les communautés autochtones. Les femmes de ces communautés sont à la fois en mesure de dire que les blancs bafouent les traditions autochtones et en même temps de dénoncer la manière dont les hommes de leur communauté tentent de les faire taire, en prétendant que le féminisme est « colonialiste ». Joyce Green dit que c’est plus compliqué que cela, et que les femmes autochtones peuvent évidemment être elles aussi féministes. Les afro-féministes disent la même chose quand elles expliquent qu’un homme noir, qui brutalise sa fille ou sa conjointe, qui la violente sexuellement, incarne le sexisme et le patriarcat. Leurs opposants, des hommes afro-américains, disent de ces afro-féministes qu’elles s’allient aux féministes blanches, et qu’elles trahissent la race en devenant « carcérales », en conduisant les hommes noirs en prison. Or, l’intersectionnalité tente de faire comprendre à quel point tout ça est compliqué, car si les hommes noirs aux États-Unis sont si nombreux en prisons, cela ne justifie certainement pas les violences machistes que subissent les femmes afro-américaines.
Il est crucial de chercher et soutenir ceux et celles qui luttent pour la cause des femmes, dans différentes situations.
Ce qui m’inspire dans mon travail d’homme proféministe, c’est d’aller lire les afro-féministes, mais aussi les hommes afro-américains féministes. Dans mon livre, j’ai montré qu’il y a une longue tradition d’hommes afro-américains qui ont appuyé le mouvement des femmes, y compris pour le droit de vote des femmes blanches même s’ils savaient alors que cette proposition d’amendement constitutionnel n’allait pas donner le droit de vote aux femmes noires. Il y a d’anciens esclaves comme Frédérick Douglass, le sociologue W.E.B. Du Bois, le collectif « Black men against sexism », dans les années 1990, etc., qui se sont battus en même temps contre le racisme et le sexisme, en solidarité avec leurs « sœurs ». Lors de la révolution de 1978 en Afghanistan, des marxistes afghans ont pris le pouvoir et instauré des lois pour l’égalité des sexes, permettant notamment le divorce et l’accès des femmes à l’éducation et aux divers métiers. Évidemment, comme c’était la Guerre froide, les puissances occidentales comme les États-Unis et la France ont tout fait pour faire tomber ce régime, sans aucune préoccupation pour les droits des femmes. Il est donc crucial de chercher et de soutenir ceux et celles qui luttent pour la cause des femmes, dans différentes situations : quand on cherche, on en trouve toujours.
Propos recueillis par Marine Quennehen et Anthony Pregnolato