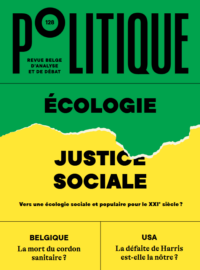Extrême droite
Où s’arrête le cordon sanitaire ?
26.01.2025

En Belgique francophone, la légitimité du cordon sanitaire contre les partis antidémocratiques est de plus en plus remise en question. Sommes-nous en train de rejoindre la confusion actuelle de nos voisin·es français·es ?
Outre-Quiévrain, le respect du « barrage républicain » contre l’extrême droite, lors des élections, semble de plus en plus aléatoire. Le gouvernement tenait d’ailleurs grâce au soutien implicite du Rassemblement National, et des concepts mal définis comme « l’arc républicain » en viennent à être interprétés comme visant davantage les partis de gauche rassemblés dans le Nouveau Front populaire que le Rassemblement national…
Malgré des remises en causes, dans le Plat pays, le principe du cordon sanitaire jouit encore d’un niveau de soutien incomparablement plus solide. Mais les partisans de cette exclusion ou démarcation des partis anti-démocratiques sont-ils toujours capables de la justifier de manière argumentée ?
Les objections ne manquent pas : comment justifier ce traitement différencié envers des partis rassemblant parfois des millions d’ électeur·ices ? N’y aurait-il pas là un déni de démocratie ? Et puis, peut-on vraiment qualifier « d’anti-démocratiques » des partis d’extrême droite, comme le Vlaams Belang ou le Rassemblement national, qui participent à la compétition électorale ? À l’inverse, faudrait-il, comme le suggèrent certain·es, étendre ce mécanisme aux partis d’extrême gauche ou de gauche radicale ?
La démocratie comme dictature de la majorité ?
Au fond, la réponse à ces questions dépend de la conception qu’on a de la démocratie. Une première réponse, pas très convaincante, est celle de la conception « majoritariste » de la démocratie (parfois qualifiée de « populiste », mais l’usage du terme fait débat). Selon cette conception, la seule chose qui importe, en démocratie, c’est la volonté du peuple, assimilée à la volonté de la majorité.
________________
Découvrez la vidéo de Maxime Lambrecht, alias Philoxime.
________________
Dans une telle conception, pour qu’un parti politique soit considéré comme légitime, il suffit qu’il puisse se revendiquer de la volonté populaire, par les sondages ou par les urnes. Et donc, si « le peuple » décide de mettre au pouvoir le pire des autocrates, il n’y aurait rien à y redire. C’est évidemment la conception de la démocratie qui est soutenue par l’extrême droite, et on peut la trouver un peu simpliste. C’est une conception de ce genre qui semblait animer le ministre de l’intérieur français, Bruno Retailleau lors qu’il soutenait que « l’État de droit, ça n’est pas intangible ni sacré », car, ajoute t-il, « la source de l’État de droit c’est la démocratie, c’est le peuple souverain ». Or, bien sûr, la démocratie ne se limite pas à ce fétichisme de la volonté populaire, et l’État de droit ne tire pas simplement sa légitimité de la volonté (forcément contingente) des électeurs…
Les élections… et rien de plus ?
Une autre réponse, pas beaucoup plus convaincante, à la question de la définition de la démocratie, est la conception « minimaliste » de la démocratie, selon laquelle celle-ci se résume à « un système où les dirigeants sont sélection nés par des élections concurrentielles » et dont le principal mérite est d’assurer la transmission pacifique du pouvoir et d’éviter la guerre civile. Donc pour les partisans de cette conception minima liste, la démocratie, c’est juste les élections (tant qu’elles sont libres et équitables).
Et les partisans de cette approche vous feront peut-être la confidence qu’ils sont personnellement opposés à l’idéologie de l’extrême-droite, mais ajouteront bien vite que la seule façon de la combattre, c’est par le débat politique et la compétition électorale. Ils tendront donc à défendre une vision absolutiste de la liberté d’expression et d’association, et à faire confiance au « libre marché des idées » électorales pour vaincre l’extrême droite (ce qui paraît hasardeux face à des personnages qui ont souvent tendance à recourir à des rhé toriques trompeuses et à des arguments fallacieux…). Mais tant que ces partis ne remettent pas en cause les procédures démocratiques de base, comme le principe du suffrage, ou les résultats des élections, ils doivent être traités comme n’importe quel autre parti. Et il faut re connaître que respecter le résultat des élections, ce n’est plus toujours évident aujourd’hui, même dans de vénérables démocraties représentatives comme les États-Unis d’Amérique…
Le problème de cette conception minimaliste de la démocratie, c’est évidemment qu’elle est très peu exigeante : pour pouvoir être qualifié de démocratie, il suffit qu’un pays organise des élections plus ou moins libres et compétitives. D’après cette conception, un pays comme Singapour, où le même gouvernement est au pouvoir depuis 1965, où le droit à la vie privée n’existe pas, la surveillance de masse parfaitement légale et où les journalistes et défenseurs des droits humains sont harcelés et réprimés, serait un régime démocratique parce qu’il organise des élections (Singapour a un score de 0.74 au Free and fair election index, ce qui n’est pas si mal).
La Malaisie, où la même coalition se maintient au pouvoir quasiment sans interruption depuis 1957, en manipulant les circonscriptions électorales, et où le travail forcé (auquel sont soumis un tiers des migrants), la torture et les exécutions arbitraires sont fréquents, serait une démocratie parce qu’elle organise des élections (score de 0.59 au Free and fair election index). De même, la Hongrie de Orbán, où les enfants Roms sont séparés de leurs parents et où une loi interdit la soi-disant « propagande LGBT », serait une démocratie parce qu’elle organise des élections (score de 0.61 au Free and fair election index)…
Un ensemble de principes
Bref, ce que tout cela suggère, c’est que réduire la démocratie aux élections paraît bien insuffisant. Dès lors, il faudrait peut-être adopter une définition plus substantielle de la démocratie, qui ne se limite pas aux élections, mais inclut également des principes et des valeurs, comme les garanties constitutionnelles de l’État de droit, la liberté et l’égalité politique, la défense des droits humains et la protection des minorités.
Dans cette optique, quand on parle de « démocratie », un régime que l’on veut défendre et approfondir, il est clair qu’on ne parle pas d’autocraties électorales comme la Malaisie, Singapour, ou la Hongrie, mais plutôt de démocratie constitutionnelle ou libérale, un régime visant à éviter que la démocratie ne se transforme en tyrannie de la majorité, et permettant d’inclure les préoccupations des minorités, qui sinon seraient inaudibles, noyées dans la masse (cf. Rummens & Abts, 2010).
Il convient donc de dépasser les conceptions simplistes de la démocratie qui prévalent trop souvent dans le débat public, et reconnaître que ce qu’on entend aujourd’hui quand on parle de régimes « démocratiques », ce sont des démocraties « constitutionnelles » ou « libérales »1, régimes visant à réaliser le projet toujours inachevé de mettre en œuvre l’idéal démocratique.
Suivant cette conception, les partis d’extrême droite apparaissent clairement comme anti-démocratiques. En effet, ils n’ont de cesse de contester les valeurs et les principes fondamentaux de la démocratie constitutionnelle ou libérale.
Ainsi, ils adoptent souvent une rhétorique incendiaire vis-à-vis des institutions indépendantes, censées servir de contre-pouvoir dans une démocratie constitutionnelle.
Hostilité aux contre-pouvoirs
Parmi leurs cibles classiques, les médias et les ONG (accusés d’être la solde de la gauche, du mondialisme ou du « wokisme »), mais aussi les juges, régulièrement accusés d’être politisés (souvent lors de poursuites pénales impliquant ces partis) ou de dériver dangereusement vers un supposé « gouvernement des juges » (lorsqu’ils défendent les droits fondamentaux, par le contrôle de constitutionnalité des lois).
Et cette hargne contre les juges ou les médias trouve sa source non seulement dans la conception majoritariste de la démocratie, mais également dans la conception fantasmée qu’a l’extrême droite d’un « peuple réel » homogène, qui les conduit à s’opposer férocement au pluralisme, et aux institutions qui protègent les minorités.
En rejetant ces mécanismes, les partis d’extrême droite mettent gravement en péril la capacité du système démocratique à protéger les citoyens et citoyennes contre les abus du pouvoir, et à inclure et prendre en compte une diversité d’intérêts et de valeurs2.
Hostilité aux droits des minorités
D’après Mudde & Rovira Kaltwasser (2018), la principale menace que font peser les partis d’extrême droite concerne la protection des droits humains des minorités : « Comme ils visent à construire une ethnocratie, un modèle de démocratie selon lequel l’État appartient à une seule communauté ethnique, ils portent atteinte aux droits des minorités ethniques et religieuses, tels que les musulmans en Europe de l’Ouest et les Roms en Europe de l’Est. »
Le « nativisme » des partis d’extrême droite les conduit à appeler systématiquement à l’exclusion de certaines minorités ethniques ou religieuses en dehors du « vrai peuple », réduisant la capacité d’inclusion du système démocratique, et à appeler ouvertement à les discriminer, mettant en péril l’égalité politique.
Défendre la démocratie contre ses ennemi·es
Reconnaître ces menaces revient donc à reconnaître la fragilité de la démocratie constitutionnelle. Si l’on veut défendre ce régime politique, il est donc légitime de distinguer les adversaires politiques au sein du débat démocratique (qui doivent bien sûr être tolérés, même si on combat leurs idées), des ennemis, antagonistes du régime démocratique, qui n’en acceptent pas les principes fondamentaux et veulent le subvertir et le supplanter.
Dès lors, des politiques de démarcation comme notre cordon sanitaire politique ou médiatique constituent des moyens de lutter contre les partis antagonistes au régime démocratique, comme les partis d’extrême droite. Et les numéros du Courrier hebdomadaire du Crisp de Benjamin Biard (le premier tome portant sur le cordon politique, et le second sur le cordon médiatique) brossent un excellent panorama de la littérature sur l’efficacité de ce cordon sanitaire, que j’ai résumé dans une récente vidéo3.
« Et l’extrême gauche ? », s’impatiente Monsieur Bouchez
Mais si l’on admet tout cela pour les partis d’extrême droite, qu’en est-il de l’autre bord ? Ne faudrait-il pas aussi un cordon sanitaire vis-à-vis de partis comme le PTB en Belgique ou le NPA ou LFI en France, que certains qualifient « d’extrême gauche » ?
Il me semble que l’erreur qu’on fait sou vent dans ce débat, c’est de penser que la dangerosité d’un parti politique dé coule directement de son classement à « l’extrême » (droite ou gauche). Mais si « extrême » peut parfois être utilisé dans le sens « d’extrémiste », il peut également avoir un sens positionnel : « à l’extrême (gauche ou droite) du spectre politique », ou plus matériellement, du centre de l’assemblée parlementaire.
Bref, ce qui compte pour savoir si des partis doivent être considérés comme antidémocratiques, ce n’est pas la présence du mot « extrême » dans la taxonomie qui leur est appliquée, mais c’est de savoir si ces partis sont hostiles aux principes et aux valeurs de la démocratie constitutionnelle.
Et il me semble que dans le programme ou le discours de la plupart des partis d’extrême gauche ou de gauche radicale qui ont un poids électoral, aujourd’hui, dans nos pays, on ne trouve pas d’atteinte au pluralisme, ou de revendications visant à créer des discriminations entre individus ou à limiter les droits humains fondamentaux. On peut bien sûr ne pas être d’accord avec cette affirmation, et estimer qu’il y a lieu de considérer que certains de ces partis sont opposés aux principes ou aux valeurs de la démocratie, mais alors il faut l’argumenter, il ne suffit pas de crier à l’« extrême gauche ».
Et les Ouïghours ?
Un argument quelquefois avancé invoque la position, parfois ambiguë, de ces partis vis-à-vis de dictatures et d’États responsables d’atteintes aux droits humains, comme le Venezuela, la Chine ou la Syrie. C’était l’argument de Corentin de Salle, il y a quelques mois, dans l’émission « Déclic » sur La Première pour justifier la proposition du MR d’élargir le cordon sanitaire au PTB. Or, si l’on peut bien sûr critiquer les ambiguïtés de partis comme le PTB ou la France Insoumise sur les relations internationales, on peut se demander s’il s’agit là d’un bon critère de délimitation. En effet, combien de gouvernements n’ont-ils pas eu une attitude ambigüe vis-à-vis de régimes autoritaires comme la Chine ou l’Arabie Saoudite pour conclure de juteux partenariats économiques ?
Combien de gouvernements continuent-ils de soutenir politiquement ou militairement Israël, malgré les crimes de guerres commis à Gaza et au Liban, et l’ouverture d’une procédure devant la Cour internationale de justice pour atteinte à la convention de Genève pour la prévention et la répression du crime de génocide ? D’ici à ce que tous les partis balaient devant leur porte, quant à leur attachement à la défense des droits humains, y compris dans les relations internationales – et il serait temps – il paraît périlleux de suggérer de s’y fier pour délimiter l’étendue du cordon sanitaire.
Se fonder dans un argumentaire précis et rigoureux
Pour le reste, force est de constater que les arguments étayés en faveur d’un tel élargissement du cordon sanitaire aux partis d’extrême gauche ou de gauche radicale sont assez rares. Or, appliquer un cordon sanitaire à tel ou tel parti n’est pas une mince décision. Pour justifier une telle mesure, il importe donc de se fonder dans un argumentaire précis et rigoureux. Et si la charge de la preuve incombe à ceux qui voudraient remettre en cause le cordon sanitaire en place, ce sont tous les démocrates qui devraient s’intéresser à la justification de ce cor don, pour pouvoir le défendre, et éviter de tendre la perche à des raisonnements simplistes.